0:00
0:00
Voici un ouvrage indispensable. A lire, malgré nombre de points très discutables, par tous ceux et celles qu’interrogent sérieusement les perspectives d’éduquer un enfant : un « métier impossible », rappelait Freud. « L’essentiel » regroupe quelques-uns des principaux ouvrages d’Alice Miller, analyste suisse d’origine polonaise, membre de l’API avant de rompre avec la psychanalyse traditionnelle. Et d’entamer le combat de sa vie contre les méfaits de la « pédagogie noire », cette éducation « qui vise à briser la volonté de l’enfant » ou d’exercer sur lui un « chantage » ou une « manipulation » afin d’en « faire un sujet docile ».
Dans une éclairante introduction, son fils Martin retrace les éléments d’une biographie qui ont pu nourrir les principales théories d’Alice Miller : difficultés de « suivre les règles sévères imposées par la religion juive » et de « donner du sens à ce qu’elle subissait ». « Des contraintes éducatives intériorisées » qui rendent le « vécu d’enfant » aliénant, sinon « meurtrier ». Autant de motifs pour une névrose ultérieure que la psychanalyse ne serait plus, selon elle, à même de prendre en charge depuis l’abandon par Freud de sa « neurotica » : dans une lettre à son ami Fliess du 21 septembre 1897, Sigmund Freud jette l’éponge sur une théorie qui obligeait à « toujours accuser le père de perversion » alors qu’il n’était pas possible, chez les patients, « de distinguer la vérité et la fiction investie d’affect ». Alice Miller dénonce cet arrangement du fondateur de la psychanalyse avec les impératifs de reconnaissance de sa nouvelle science et ses conséquences sur la pratique freudienne qui « condamne le patient au déni de sa propre vérité, traite son vécu émotionnel de fantasme et lui demande de considérer les agissements de ses parents comme de l’amour ». L’ordonnancement chronologique des textes par Flammarion permet de suivre les évolutions d’Alice Miller : de la préface où elle semble rendre hommage aux capacités de « compréhension profonde » de situations qui « reposent sur l’expérience analytique » jusqu’à ses derniers écrits, à l’image de « La connaissance interdite » ou de « Notre corps ne ment jamais », nettement plus acérés contre la psychologie des profondeurs.
On ne manquera pas ainsi de lire -ou de relire- avec un intérêt particulier « C’est pour ton bien », ouvrage de 1985 où l’auteur s’efforce -non sans arguments valables- de montrer, notamment avec le cas d’Adolf Hitler qu’elle étaye sur nombre de biographies lues avec son regard critique ou avec celui de Jürgen Bartsch, comment un enfant violemment maltraité restitue compulsivement sur autrui à l’âge adulte, la cruauté psychique dont il a été victime. Au point de pouvoir étendre la comparaison avec Rudolph Höss ou Heinrich Himmler, tous deux fruits d’une « obéissance absolue » à un système de « valeurs sacrées » et assimilé à des « ordres à exécuter ». Elle cite d’ailleurs un épisode révélateur du procès d’Eichmann, écoutant sans sourciller les témoignages tragiques sur ses exactions mais « rougissant d’embarras » quant on lui fit remarquer qu’il ne s’était pas levé au moment de la sentence. Et de conclure : « des individus qui peuvent s’emparer des masses dès lors qu’ils représentent leur système d’éducation ».
Dans une éclairante introduction, son fils Martin retrace les éléments d’une biographie qui ont pu nourrir les principales théories d’Alice Miller : difficultés de « suivre les règles sévères imposées par la religion juive » et de « donner du sens à ce qu’elle subissait ». « Des contraintes éducatives intériorisées » qui rendent le « vécu d’enfant » aliénant, sinon « meurtrier ». Autant de motifs pour une névrose ultérieure que la psychanalyse ne serait plus, selon elle, à même de prendre en charge depuis l’abandon par Freud de sa « neurotica » : dans une lettre à son ami Fliess du 21 septembre 1897, Sigmund Freud jette l’éponge sur une théorie qui obligeait à « toujours accuser le père de perversion » alors qu’il n’était pas possible, chez les patients, « de distinguer la vérité et la fiction investie d’affect ». Alice Miller dénonce cet arrangement du fondateur de la psychanalyse avec les impératifs de reconnaissance de sa nouvelle science et ses conséquences sur la pratique freudienne qui « condamne le patient au déni de sa propre vérité, traite son vécu émotionnel de fantasme et lui demande de considérer les agissements de ses parents comme de l’amour ». L’ordonnancement chronologique des textes par Flammarion permet de suivre les évolutions d’Alice Miller : de la préface où elle semble rendre hommage aux capacités de « compréhension profonde » de situations qui « reposent sur l’expérience analytique » jusqu’à ses derniers écrits, à l’image de « La connaissance interdite » ou de « Notre corps ne ment jamais », nettement plus acérés contre la psychologie des profondeurs.
On ne manquera pas ainsi de lire -ou de relire- avec un intérêt particulier « C’est pour ton bien », ouvrage de 1985 où l’auteur s’efforce -non sans arguments valables- de montrer, notamment avec le cas d’Adolf Hitler qu’elle étaye sur nombre de biographies lues avec son regard critique ou avec celui de Jürgen Bartsch, comment un enfant violemment maltraité restitue compulsivement sur autrui à l’âge adulte, la cruauté psychique dont il a été victime. Au point de pouvoir étendre la comparaison avec Rudolph Höss ou Heinrich Himmler, tous deux fruits d’une « obéissance absolue » à un système de « valeurs sacrées » et assimilé à des « ordres à exécuter ». Elle cite d’ailleurs un épisode révélateur du procès d’Eichmann, écoutant sans sourciller les témoignages tragiques sur ses exactions mais « rougissant d’embarras » quant on lui fit remarquer qu’il ne s’était pas levé au moment de la sentence. Et de conclure : « des individus qui peuvent s’emparer des masses dès lors qu’ils représentent leur système d’éducation ».
La psychanalyse en opposition radicale avec l'éducation
Malgré l’émouvante sincérité de son engagement qui rend passionnante la lecture des mille pages de cet ouvrage, deux critiques principales peuvent être adressées à son auteur. Elles concernent « sa » conception de la psychanalyse.
Dans « L’enfant sous la terreur », Alice Miller regrette le « vocabulaire aliénant » de la psychanalyse et voit « dans ses dogmes des facteurs susceptibles d’entraver le développement de la théorie et de la pratique ». Etonnamment, elle accuse cette dernière « d’épargner les parents » et, finalement, de chercher à « éduquer le patient ». Etrange assertion, fut-elle nourrie d’une psychologie américanisée du Moi, tant Freud dans ses « Conseils aux médecins » (1912) appelle ces derniers à la vigilance sur leur « tentation de la fonction éducative ». Certes, après avoir cru à la possibilité offerte par la psychanalyse d’offrir une « éducation guidée par une éthique de la vérité substituée à une morale fondée sur l’illusion et la méconnaissance », le père de la psychanalyse élimina toute idée en la matière. Moins pour soutenir une « répression éducative » comme semble le croire Alice Miller que par sa conviction profonde: « l’ébranlement » provoqué par l’analyse et la nature de cette dernière sont en opposition radicale avec tout processus éducatif (Catherine Millot, « Freud Antipédagogue », Champs Flammarion, 1997).
La deuxième critique concerne le revirement de Freud sur sa « neurotica ». Dans son chapitre « La réalité de la petite enfance dans la pratique de la psychanalyse », Alice Miller affirme que son expérience démontre « l’effondrement de la théorie freudienne des pulsions » face à celle de la séduction réelle de l’enfant par l’adulte. Mais nombre de Freudiens ont repris et travaillé cette approche au point d’en faire leur théorie centrale, à l’image de celle de la « séduction généralisée » du Pr Laplanche. Certains ont même étendu la question de l’acte incestueux au « climat incestuel », encore plus complexe à déchiffrer et sur lequel, en l’absence d’acte physique, le patient peine davantage à perlaborer (Paul-Claude Racamier, « L’inceste et l’incestuel », Editions du Collège 1995, Rééd. Dunod 2010). Les propos d’Alice Miller frisent donc le procès d’intention.
A la fin de l’ouvrage, Alice Miller se raconte. Intimement. Propos qui bouclent en retour -et en miroir- le récit introductif de son fils. Le titre de cet ultime chapitre fait immanquablement songer à la formule de Lacan sur les dires du patient. « Notre corps ne ment jamais » écrit Alice Miller. Mais dit-il toute la vérité ?
L’essentiel d’Alice Miller, Editions Flammarion, 2011.
Dans « L’enfant sous la terreur », Alice Miller regrette le « vocabulaire aliénant » de la psychanalyse et voit « dans ses dogmes des facteurs susceptibles d’entraver le développement de la théorie et de la pratique ». Etonnamment, elle accuse cette dernière « d’épargner les parents » et, finalement, de chercher à « éduquer le patient ». Etrange assertion, fut-elle nourrie d’une psychologie américanisée du Moi, tant Freud dans ses « Conseils aux médecins » (1912) appelle ces derniers à la vigilance sur leur « tentation de la fonction éducative ». Certes, après avoir cru à la possibilité offerte par la psychanalyse d’offrir une « éducation guidée par une éthique de la vérité substituée à une morale fondée sur l’illusion et la méconnaissance », le père de la psychanalyse élimina toute idée en la matière. Moins pour soutenir une « répression éducative » comme semble le croire Alice Miller que par sa conviction profonde: « l’ébranlement » provoqué par l’analyse et la nature de cette dernière sont en opposition radicale avec tout processus éducatif (Catherine Millot, « Freud Antipédagogue », Champs Flammarion, 1997).
La deuxième critique concerne le revirement de Freud sur sa « neurotica ». Dans son chapitre « La réalité de la petite enfance dans la pratique de la psychanalyse », Alice Miller affirme que son expérience démontre « l’effondrement de la théorie freudienne des pulsions » face à celle de la séduction réelle de l’enfant par l’adulte. Mais nombre de Freudiens ont repris et travaillé cette approche au point d’en faire leur théorie centrale, à l’image de celle de la « séduction généralisée » du Pr Laplanche. Certains ont même étendu la question de l’acte incestueux au « climat incestuel », encore plus complexe à déchiffrer et sur lequel, en l’absence d’acte physique, le patient peine davantage à perlaborer (Paul-Claude Racamier, « L’inceste et l’incestuel », Editions du Collège 1995, Rééd. Dunod 2010). Les propos d’Alice Miller frisent donc le procès d’intention.
A la fin de l’ouvrage, Alice Miller se raconte. Intimement. Propos qui bouclent en retour -et en miroir- le récit introductif de son fils. Le titre de cet ultime chapitre fait immanquablement songer à la formule de Lacan sur les dires du patient. « Notre corps ne ment jamais » écrit Alice Miller. Mais dit-il toute la vérité ?
L’essentiel d’Alice Miller, Editions Flammarion, 2011.
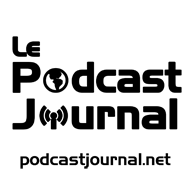




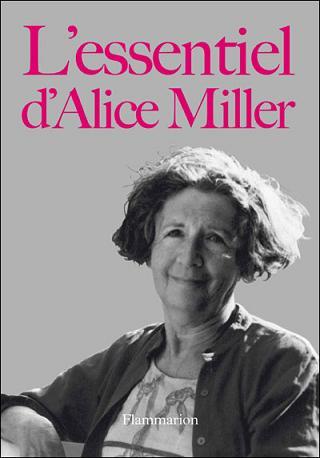





 A Mexico, bientôt la corrida sans cruauté
A Mexico, bientôt la corrida sans cruauté








