
Dr Ouoba Bendi Bénoit, rédacteur principal du redoutable dictionnaire bilingue (photo DR)
Comment êtes-vous arrivés à la fabrication du premier dictionnaire dans votre langue ?
Je me suis outillé dans le domaine. Vous savez à l’université ce sont des spécialisations. Après la linguistique générale que tout le monde fait, appliquée à l’étude des langues africaines. Je me suis spécialisé en lexicologie et en lexicographie qui est la science de la fabrication des dictionnaires. Donc je me suis investi, j’ai enseigné cette spécialisation et donc je n’ai fait qu’appliquer certains éléments de mon cours.
Il y a souvent deux langues voisines (Bogandé et Fada) mais qui ne se comprennent pas sont-ce pour autant des murs inutiles ?
Chaque langue connait des variations géographiques. En allant d’un lieu à un autre, la langue est parlée différemment. Ces différences peuvent être telles que l’intercompréhension devient difficile. On parle donc de dialecte de la même langue. C’est la poule et l’œuf en parlant de langue et de dialecte. Entre le gulmancéma du nord et celui du sud il y avait cette différence d’intercompréhension. On a étudié d’abord scientifiquement d’où venait la différence. On a vu qu’au niveau du lexique, c’est-à-dire des mots que les gens utilisent, il n’y avait pas de différence ou disons très peu. Dans notre corpus on a trouvé trois mots qu’on ne trouve pas de l’autre côté. On peut trouver des formes vieillies qui ne sont plus utilisées que d’un côté. Par exemple pour dire : être fatigué. Au sud comme au nord les radicaux des mots étaient les mêmes mais c’est au niveau de l’intonation des mots que cela changeait.
Des locuteurs soulagés après vos résultats ?
Ça été très bien accueilli. Avoir un dictionnaire ce n’est pas rien. C’est visible. D’avoir une référence, le fait d’ouvrir des classes d’alphabétisation. Les gens sont très contents. On ne parle pas une langue par plaisir mais par nécessité.
Quelle politique pour les langues au Burkina pour les 50 ans à venir?
Il faut être très prudent quand on parle du choix des langues. Si on représente l'autorité, on est obligé de choisir certaines langues par le fait de leur poids qu’il représente. Il faut éviter d’exclure automatiquement. Il n’y a pas de minorité quand il s’agit d’être humain. Une minorité peut empêcher une majorité de dormir. Ça ne doit pas se faire par décret. Pour éviter les interprétations malsaines. Pour un pays comme le Burkina, nous avons fait la décentralisation intégrale ; partons de là. Utilisons les langues parlées dans la localité. Si on part de la base on va promouvoir en montant de la commune à la région sans enfermer ces locuteurs. Dès que quelqu’un peut lire dans une langue, on peut en apprendre une autre. Prenons un pays comme les Pays-Bas. Où le néerlandais est parlé en famille. A l’école, c’est l’anglais ou l’allemand plus la langue néerlandaise - enseignée aussi. Une bonne politique devrait permettre à chacun d’articuler sa langue à une autre, nationale. De proche en proche on atteint le pays.
En France aujourd’hui, après 500 ans d’interdiction, les gens choisissent de faire leur Bac en Breton. Donc nous ne sommes pas obligés de faire les erreurs des autres. Il faut travailler à promouvoir certaines langues déjà au Burkina, dans la presse, sur les antennes. Malgré le quart d’heure aucune langue ne se plaint. Donc prudence et puis choix judicieux, il faut choisir sans choisir. Ce que je dis est valable pour tout politique linguistique. Les tigres tamouls ont pris les armes à cause du choix des langues en leur défaveur. C’est un problème culturel. Ça fait plus de 20 ans de guerre.
De votre journal Laabaali 20 ans après ?
Aujourd’hui, Tin Tua, c’est le Sahel. C’est le Banwa et les Hauts-Bassins. Je vois la nation maintenant pas seulement l’est. Quand on fait le point on a presque paru chaque mois pendant 20 ans. Les annonces de nos concours y sont diffusées et les candidats font parfois des photocopies. C’est un journal incontournable dans la région de l’est. Personne ne se plaindra qu’il n’a pas eu assez d’information au sujet du concours que nous organisions car il a lu le journal. C’est Laabaali. C’est-à-dire l’information en Gulmancéma.
Et le cinquantenaire selon vous?
Cinquante ans ça se fête. En tant qu’intellectuel, on peut se poser des questions. D’emblée on peut jeter la pierre aux dirigeants. Les intellectuels on leur part de responsabilité. Et cela ne prive pas les gens de faire la fête.
Je me suis outillé dans le domaine. Vous savez à l’université ce sont des spécialisations. Après la linguistique générale que tout le monde fait, appliquée à l’étude des langues africaines. Je me suis spécialisé en lexicologie et en lexicographie qui est la science de la fabrication des dictionnaires. Donc je me suis investi, j’ai enseigné cette spécialisation et donc je n’ai fait qu’appliquer certains éléments de mon cours.
Il y a souvent deux langues voisines (Bogandé et Fada) mais qui ne se comprennent pas sont-ce pour autant des murs inutiles ?
Chaque langue connait des variations géographiques. En allant d’un lieu à un autre, la langue est parlée différemment. Ces différences peuvent être telles que l’intercompréhension devient difficile. On parle donc de dialecte de la même langue. C’est la poule et l’œuf en parlant de langue et de dialecte. Entre le gulmancéma du nord et celui du sud il y avait cette différence d’intercompréhension. On a étudié d’abord scientifiquement d’où venait la différence. On a vu qu’au niveau du lexique, c’est-à-dire des mots que les gens utilisent, il n’y avait pas de différence ou disons très peu. Dans notre corpus on a trouvé trois mots qu’on ne trouve pas de l’autre côté. On peut trouver des formes vieillies qui ne sont plus utilisées que d’un côté. Par exemple pour dire : être fatigué. Au sud comme au nord les radicaux des mots étaient les mêmes mais c’est au niveau de l’intonation des mots que cela changeait.
Des locuteurs soulagés après vos résultats ?
Ça été très bien accueilli. Avoir un dictionnaire ce n’est pas rien. C’est visible. D’avoir une référence, le fait d’ouvrir des classes d’alphabétisation. Les gens sont très contents. On ne parle pas une langue par plaisir mais par nécessité.
Quelle politique pour les langues au Burkina pour les 50 ans à venir?
Il faut être très prudent quand on parle du choix des langues. Si on représente l'autorité, on est obligé de choisir certaines langues par le fait de leur poids qu’il représente. Il faut éviter d’exclure automatiquement. Il n’y a pas de minorité quand il s’agit d’être humain. Une minorité peut empêcher une majorité de dormir. Ça ne doit pas se faire par décret. Pour éviter les interprétations malsaines. Pour un pays comme le Burkina, nous avons fait la décentralisation intégrale ; partons de là. Utilisons les langues parlées dans la localité. Si on part de la base on va promouvoir en montant de la commune à la région sans enfermer ces locuteurs. Dès que quelqu’un peut lire dans une langue, on peut en apprendre une autre. Prenons un pays comme les Pays-Bas. Où le néerlandais est parlé en famille. A l’école, c’est l’anglais ou l’allemand plus la langue néerlandaise - enseignée aussi. Une bonne politique devrait permettre à chacun d’articuler sa langue à une autre, nationale. De proche en proche on atteint le pays.
En France aujourd’hui, après 500 ans d’interdiction, les gens choisissent de faire leur Bac en Breton. Donc nous ne sommes pas obligés de faire les erreurs des autres. Il faut travailler à promouvoir certaines langues déjà au Burkina, dans la presse, sur les antennes. Malgré le quart d’heure aucune langue ne se plaint. Donc prudence et puis choix judicieux, il faut choisir sans choisir. Ce que je dis est valable pour tout politique linguistique. Les tigres tamouls ont pris les armes à cause du choix des langues en leur défaveur. C’est un problème culturel. Ça fait plus de 20 ans de guerre.
De votre journal Laabaali 20 ans après ?
Aujourd’hui, Tin Tua, c’est le Sahel. C’est le Banwa et les Hauts-Bassins. Je vois la nation maintenant pas seulement l’est. Quand on fait le point on a presque paru chaque mois pendant 20 ans. Les annonces de nos concours y sont diffusées et les candidats font parfois des photocopies. C’est un journal incontournable dans la région de l’est. Personne ne se plaindra qu’il n’a pas eu assez d’information au sujet du concours que nous organisions car il a lu le journal. C’est Laabaali. C’est-à-dire l’information en Gulmancéma.
Et le cinquantenaire selon vous?
Cinquante ans ça se fête. En tant qu’intellectuel, on peut se poser des questions. D’emblée on peut jeter la pierre aux dirigeants. Les intellectuels on leur part de responsabilité. Et cela ne prive pas les gens de faire la fête.
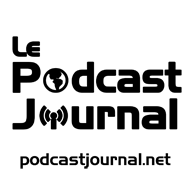









 Les dernières actus du Gabon
Les dernières actus du Gabon









