Une Madame Chrysanthème en copiée presque collée
0:00
0:00
Vue et revue en France et en Navarre, la "Madame Butterfly" signée par Numa Sadoul retrouvait en ce mois de mars, son lieu de création.
L’impression est toujours violente et nous tenons là certainement l’une des réalisations les plus abouties et parfaites de l’éternel et larmoyant chef d’œuvre de Puccini.
Point de "japoniaiseries" de carte postale dans ce spectacle qui s’imposa voici dix ans par la rigueur de la pensée comme par celle des moyens employés pour la traduire. Robuste production, d’une picturalité exceptionnelle dans sa "zen-attitude", dans sa nudité crue mais aussi poétique, c’est-à-dire le côté humain d’une lorgnette qui pointe dès le premier acte sur Cio-Cio-San pour ne plus la quitter.
Les décors simples de Luc Londiveau figurent une maison ouverte au ciel, à la mer, dans un no man’s land noir et laqué comme un catafalque, les costumes sans exotisme tapageur de Katia Duflot, ne représentant finalement qu’un cadre plat, la chronique sanguinaire, amère et immorale d’une gamine de quinze ans vendue et devenue le jouet d’une Amérique triomphante. Une ne machination sanguinolente qui possède alors toute la multiplicité des paraboles riches de tout ce qu’on y devine.
En s’attachant à dé-japoniser l’intrigue pour mieux en resserrer le propos, pour mieux en saisir le psychologisme cru, Numa Sadoul égratigne au passage ce Monsieur Pinkerton saisi par la débauche - et son pays donc! - pour délivrer, immonde et cruel, un reportage-vérité, pseudo-didactique d’un vieux mythe romantico-machiste.
Prise à la loupe, Svetla Vassileva aborde la solitude de Butterfly, ses emportements, ses abandons, ses rancœurs, ses désespoirs avec un naturel évident. Craintive, éveillée, elle dit avec grâce et émoi ce qui touche au cœur sur un ton mélancolique et pudique, intime et feutré qui évoque le quotidien. Le timbre, idéal, ne force jamais ce frêle équilibre qui existe tout au long de l’œuvre entre langueur poétique et brusquerie réaliste, comme pour mieux isoler, cran par cran, chaque moment, chaque temps.
Déboussolé, en fuite dès les premiers instants, le goujat cynique, insipide et pitoyable Pinkerton de Teodor Ilincai se disloque au premier soleil, avec raison. La voix, sensible, passionnée, tenace, charrie pêle-mêle la rage et l’amour.
Le Sharpless de Paulo Szot est dramatiquement solide, admirablement caractérisé. Ce consul a choisi son camp, ce sera celui de Butterfly. Excellent.
Le mezzo musclé et si bien contrôlé de Cornelia Oncioiu donne à Suzuki un poids qu’elle n’a pas toujours.
Fort bien en place également la Kate Pinkerton de la jolie Jennifer Michel, le Bonze terrifiant de présence de Jean-Marie Delpas et le Goro dégoulinant de rouerie toute putassière de Rodolphe Briand.
La direction de Nader Abassi, sans doute le chef le plus attachant de sa génération, dessinait superbement l’univers orchestral de Puccini avec un orientalisme étrangement familier, des paroxysmes sans pathos. Pour donner vie et une musicalité constante, un souffle très authentique à la partition. Le chœur à bouche fermée étant le plus magique qui soit.
La veille de cette dernière représentation de "Butterfly", c’est à une bien belle découverte que nous convia Maurice Xiberras en proposant, à un public hélas clairsemé, en version de concert, la "Madame Chrysanthème" d’André Messager.
Écrite en 1893, cette œuvre ambitieuse qui précède de dix ans "Butterfly", narre, sur un sujet de Pierre Loti, les amours malheureuses d’une japonaise avec une enseigne de vaisseau. Œuvre autobiographique pour certains, exotisme de pacotille pour d’autres…
Reconnaissons une estampille musicale délicieuse, une intrigue très loin de Puccini (contrairement à ce que prétend le programme, car ici point d’enfant, point de hara-kiri), une peinture assez rigolote d’un Nagasaki vu des bords de Seine, et un rôle-titre attachant comme pas deux.
Annick Massis, n’en fait qu’une bouchée. Musicienne en diable, avec des regards, des mimiques qui n’appartiennent qu’à Elle, en prime ce délicat vibrato qui vous tourneboule toute la soirée.
Si Jean-Pierre Furlan, le cœur et la voix en bandoulière, tire le meilleur parti d’un rôle que l’on croirait écrit pour lui, le ténor doit pour un soir laisser la place à un Yann Toussaint des grands jours, frère et confident à la fois, faux rival mais vrai complice en tout.
Déjà remarqué dans "L’Aiglon" le mois dernier, ce sympathique baryton charrie des tonnes d’émotion simple avec un timbre racé, solide, haut, clair, qui sait se moirer des nuances du lied quand il le faut. Un artiste à suivre…
Rodolphe Briand cabotine au mieux en Kangourou (sans rire!) et les trois dames fleuries, sorties d’une publicité pour platebande, Lucie Roche, Sandrine Eyglier, Virginie Fenu font plus que de simples apparitions et s’imposent avec naturel, grâce mutine.
Surmontant les dangers d’une version de concert (qui aurait méritée d’être sur-titrée), Victorien Vanoosten avec sa battue ferme et délicate à la fois, teintée d’érotisme à la française très fin de siècle, dans un joli équilibre fosse-plateau, tire la substantifique moelle d’une partition délicate, fleur-bleue, poétique quand il le faut, fascinante toujours.
L’impression est toujours violente et nous tenons là certainement l’une des réalisations les plus abouties et parfaites de l’éternel et larmoyant chef d’œuvre de Puccini.
Point de "japoniaiseries" de carte postale dans ce spectacle qui s’imposa voici dix ans par la rigueur de la pensée comme par celle des moyens employés pour la traduire. Robuste production, d’une picturalité exceptionnelle dans sa "zen-attitude", dans sa nudité crue mais aussi poétique, c’est-à-dire le côté humain d’une lorgnette qui pointe dès le premier acte sur Cio-Cio-San pour ne plus la quitter.
Les décors simples de Luc Londiveau figurent une maison ouverte au ciel, à la mer, dans un no man’s land noir et laqué comme un catafalque, les costumes sans exotisme tapageur de Katia Duflot, ne représentant finalement qu’un cadre plat, la chronique sanguinaire, amère et immorale d’une gamine de quinze ans vendue et devenue le jouet d’une Amérique triomphante. Une ne machination sanguinolente qui possède alors toute la multiplicité des paraboles riches de tout ce qu’on y devine.
En s’attachant à dé-japoniser l’intrigue pour mieux en resserrer le propos, pour mieux en saisir le psychologisme cru, Numa Sadoul égratigne au passage ce Monsieur Pinkerton saisi par la débauche - et son pays donc! - pour délivrer, immonde et cruel, un reportage-vérité, pseudo-didactique d’un vieux mythe romantico-machiste.
Prise à la loupe, Svetla Vassileva aborde la solitude de Butterfly, ses emportements, ses abandons, ses rancœurs, ses désespoirs avec un naturel évident. Craintive, éveillée, elle dit avec grâce et émoi ce qui touche au cœur sur un ton mélancolique et pudique, intime et feutré qui évoque le quotidien. Le timbre, idéal, ne force jamais ce frêle équilibre qui existe tout au long de l’œuvre entre langueur poétique et brusquerie réaliste, comme pour mieux isoler, cran par cran, chaque moment, chaque temps.
Déboussolé, en fuite dès les premiers instants, le goujat cynique, insipide et pitoyable Pinkerton de Teodor Ilincai se disloque au premier soleil, avec raison. La voix, sensible, passionnée, tenace, charrie pêle-mêle la rage et l’amour.
Le Sharpless de Paulo Szot est dramatiquement solide, admirablement caractérisé. Ce consul a choisi son camp, ce sera celui de Butterfly. Excellent.
Le mezzo musclé et si bien contrôlé de Cornelia Oncioiu donne à Suzuki un poids qu’elle n’a pas toujours.
Fort bien en place également la Kate Pinkerton de la jolie Jennifer Michel, le Bonze terrifiant de présence de Jean-Marie Delpas et le Goro dégoulinant de rouerie toute putassière de Rodolphe Briand.
La direction de Nader Abassi, sans doute le chef le plus attachant de sa génération, dessinait superbement l’univers orchestral de Puccini avec un orientalisme étrangement familier, des paroxysmes sans pathos. Pour donner vie et une musicalité constante, un souffle très authentique à la partition. Le chœur à bouche fermée étant le plus magique qui soit.
La veille de cette dernière représentation de "Butterfly", c’est à une bien belle découverte que nous convia Maurice Xiberras en proposant, à un public hélas clairsemé, en version de concert, la "Madame Chrysanthème" d’André Messager.
Écrite en 1893, cette œuvre ambitieuse qui précède de dix ans "Butterfly", narre, sur un sujet de Pierre Loti, les amours malheureuses d’une japonaise avec une enseigne de vaisseau. Œuvre autobiographique pour certains, exotisme de pacotille pour d’autres…
Reconnaissons une estampille musicale délicieuse, une intrigue très loin de Puccini (contrairement à ce que prétend le programme, car ici point d’enfant, point de hara-kiri), une peinture assez rigolote d’un Nagasaki vu des bords de Seine, et un rôle-titre attachant comme pas deux.
Annick Massis, n’en fait qu’une bouchée. Musicienne en diable, avec des regards, des mimiques qui n’appartiennent qu’à Elle, en prime ce délicat vibrato qui vous tourneboule toute la soirée.
Si Jean-Pierre Furlan, le cœur et la voix en bandoulière, tire le meilleur parti d’un rôle que l’on croirait écrit pour lui, le ténor doit pour un soir laisser la place à un Yann Toussaint des grands jours, frère et confident à la fois, faux rival mais vrai complice en tout.
Déjà remarqué dans "L’Aiglon" le mois dernier, ce sympathique baryton charrie des tonnes d’émotion simple avec un timbre racé, solide, haut, clair, qui sait se moirer des nuances du lied quand il le faut. Un artiste à suivre…
Rodolphe Briand cabotine au mieux en Kangourou (sans rire!) et les trois dames fleuries, sorties d’une publicité pour platebande, Lucie Roche, Sandrine Eyglier, Virginie Fenu font plus que de simples apparitions et s’imposent avec naturel, grâce mutine.
Surmontant les dangers d’une version de concert (qui aurait méritée d’être sur-titrée), Victorien Vanoosten avec sa battue ferme et délicate à la fois, teintée d’érotisme à la française très fin de siècle, dans un joli équilibre fosse-plateau, tire la substantifique moelle d’une partition délicate, fleur-bleue, poétique quand il le faut, fascinante toujours.
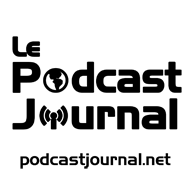











 Kicca & Oscar Marchioni sortent l'album Alegre Me Siento
Kicca & Oscar Marchioni sortent l'album Alegre Me Siento








