Un spectacle raffiné sur une musique précieuse et décadente
0:00
0:00
Ce n’est pas moins que quinze opéras qui accueillent, en octobre dernier Reims l’a vu naître, cette attachante production des "Caprices de Marianne", où bien sûr plane l’ombre de Musset, mais aussi la plume vivifiante de Jean-Pierre Grédy (sans Barillet), le tout enveloppé par les séduisantes notes d’Henri Sauguet.
On aime bien à Marseille ce compositeur. Sa "Chartreuse de Parme", voici cinq ans, avait rallié tous les suffrages. La courageuse politique de redécouverte du répertoire français est tout à l’honneur du sympathique directeur Maurice Xiberras qui se bat contre vents et marées pour maintenir sa maison au premier rang des scènes hexagonales.
Un peu d’histoire pour commencer. La commande de cet ouvrage revient au regretté Gabriel Dussurget, le fondateur du Festival d’Aix en Provence. C’est avec un succès d’estime que ces "Caprices" furent accueillis en 1954. La musique moderne faisait son entrée dans le temple de Mozart!
Malgré l’enregistrement réalisé peu de temps après par Manuel Rosenthal avec Michel Sénéchal, tenons-nous là le "Pelléas" de l’après-guerre comme le soulignait Pierre Jourdan qui osa, voici dix ans, en donner quelques représentations dans son coquet Opéra Impérial de Compiègne?
A chacun dès lors d’apprécier un orchestre discret (pas d’ouverture tonitruante ou de prélude sirupeux), une écriture fluide, mélodique, originale, subtile mais qui colle au texte revisité du bel Alfred avec malice…
Ajoutons quelques notes folklorique napolitaines, un rôle travesti de Duègne comme on en fait plus, une écriture vocale d’une relative facilité… pour finalement savourer deux heures de musique ininterrompue, raffinée, bon chic bon genre, un tantinet désuète qui sent si bien, si bon son Paris décadent et son Groupe des Six.
Le Canadien Oriol Tomas a choisi de situer ce drame de l’amour impossible et de l’orgueil mal placé dans les années cinquante mais surtout dans une écrasante, une grandiose perspective signée Patricia Ruel, copie presque conforme de la Galerie Umberto Ier avec son dôme semblable à une toile d'araignée qui prendra les protagonistes dans ses mailles maléfiques.
A gauche une gargote stylisée, à droite l'entrée du domicile de Marianne, tandis qu'au centre un édicule rond fera office de banc, de baignoire et de fontaine pour Coelio… Pour l’anecdote, son strip-tease et son bain simulé devant sa mère Hermia a fait frémir d’aise ma voisine de droite…
Tant il est vrai que Cyrille Dubois endosse le rôle de l’amoureux trahi sur un malentendu avec une conviction, un abandon, un charme romantique bourré de passion que l’on croyait perdu à l’opéra. La voix rappelle irrésistiblement celle du jeune Vanzo par son aigu solaire ou ces demi-teintes qui se moirent des accents du lied.
Philippe Nicolas-Martin fanfaronne de belle manière en Octave. Le baryton-loubard impose une écrasante présence naturelle avec une voix prometteuse, qui, si elle est bien conduite, devrait bientôt nous proposer un Valentin, un Lescaut, un Zurga de grandes classes.
Connivence rare et étudiée entre les maléfiques et tortueux Thomas Dear (Claudio) et Raphael Bremard (Tibia) qui forment avec la Duègne alcoolique et faussement bigote de Julien Bréan (véritable armoire à glace) un trio irrésistible de contrastes, drôlerie, finesse, noirceur.
Fort bien en place aussi l’aubergiste, Hermia, le chanteur de sérénade.
Suzana Markovà, superbe beauté glacée, emporte tout sur son passage. Son soprano de verre et de diamant, déjà entendu sur la scène phocéenne dans "Lucia" et "Traviata", dans un français impeccable traduit avec des moues, des attitudes dignes du Français, la coquetterie cynique et racée d’une Marianne légère et blasée, prise à son propre piège. Encore une fois on ne badine pas toujours comme l’on veut avec l’amour.
En amoureux éperdu de cette musique frivole et acide, Claude Schnitzler se montre discret, accompagne de l’œil, de l’oreille et du cœur sa troupe de jeune chanteurs, ne se contente pas d’assumer un fond musical genre musique de film Nouvelle Vague, mais tisse le plus spirituel, le plus délicat écrin qui arriverait presque à nous faire prendre cette partition décadente, déliquescente pour un total chef-d’œuvre.
On aime bien à Marseille ce compositeur. Sa "Chartreuse de Parme", voici cinq ans, avait rallié tous les suffrages. La courageuse politique de redécouverte du répertoire français est tout à l’honneur du sympathique directeur Maurice Xiberras qui se bat contre vents et marées pour maintenir sa maison au premier rang des scènes hexagonales.
Un peu d’histoire pour commencer. La commande de cet ouvrage revient au regretté Gabriel Dussurget, le fondateur du Festival d’Aix en Provence. C’est avec un succès d’estime que ces "Caprices" furent accueillis en 1954. La musique moderne faisait son entrée dans le temple de Mozart!
Malgré l’enregistrement réalisé peu de temps après par Manuel Rosenthal avec Michel Sénéchal, tenons-nous là le "Pelléas" de l’après-guerre comme le soulignait Pierre Jourdan qui osa, voici dix ans, en donner quelques représentations dans son coquet Opéra Impérial de Compiègne?
A chacun dès lors d’apprécier un orchestre discret (pas d’ouverture tonitruante ou de prélude sirupeux), une écriture fluide, mélodique, originale, subtile mais qui colle au texte revisité du bel Alfred avec malice…
Ajoutons quelques notes folklorique napolitaines, un rôle travesti de Duègne comme on en fait plus, une écriture vocale d’une relative facilité… pour finalement savourer deux heures de musique ininterrompue, raffinée, bon chic bon genre, un tantinet désuète qui sent si bien, si bon son Paris décadent et son Groupe des Six.
Le Canadien Oriol Tomas a choisi de situer ce drame de l’amour impossible et de l’orgueil mal placé dans les années cinquante mais surtout dans une écrasante, une grandiose perspective signée Patricia Ruel, copie presque conforme de la Galerie Umberto Ier avec son dôme semblable à une toile d'araignée qui prendra les protagonistes dans ses mailles maléfiques.
A gauche une gargote stylisée, à droite l'entrée du domicile de Marianne, tandis qu'au centre un édicule rond fera office de banc, de baignoire et de fontaine pour Coelio… Pour l’anecdote, son strip-tease et son bain simulé devant sa mère Hermia a fait frémir d’aise ma voisine de droite…
Tant il est vrai que Cyrille Dubois endosse le rôle de l’amoureux trahi sur un malentendu avec une conviction, un abandon, un charme romantique bourré de passion que l’on croyait perdu à l’opéra. La voix rappelle irrésistiblement celle du jeune Vanzo par son aigu solaire ou ces demi-teintes qui se moirent des accents du lied.
Philippe Nicolas-Martin fanfaronne de belle manière en Octave. Le baryton-loubard impose une écrasante présence naturelle avec une voix prometteuse, qui, si elle est bien conduite, devrait bientôt nous proposer un Valentin, un Lescaut, un Zurga de grandes classes.
Connivence rare et étudiée entre les maléfiques et tortueux Thomas Dear (Claudio) et Raphael Bremard (Tibia) qui forment avec la Duègne alcoolique et faussement bigote de Julien Bréan (véritable armoire à glace) un trio irrésistible de contrastes, drôlerie, finesse, noirceur.
Fort bien en place aussi l’aubergiste, Hermia, le chanteur de sérénade.
Suzana Markovà, superbe beauté glacée, emporte tout sur son passage. Son soprano de verre et de diamant, déjà entendu sur la scène phocéenne dans "Lucia" et "Traviata", dans un français impeccable traduit avec des moues, des attitudes dignes du Français, la coquetterie cynique et racée d’une Marianne légère et blasée, prise à son propre piège. Encore une fois on ne badine pas toujours comme l’on veut avec l’amour.
En amoureux éperdu de cette musique frivole et acide, Claude Schnitzler se montre discret, accompagne de l’œil, de l’oreille et du cœur sa troupe de jeune chanteurs, ne se contente pas d’assumer un fond musical genre musique de film Nouvelle Vague, mais tisse le plus spirituel, le plus délicat écrin qui arriverait presque à nous faire prendre cette partition décadente, déliquescente pour un total chef-d’œuvre.
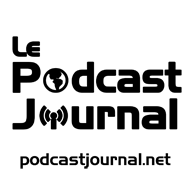











 Kicca & Oscar Marchioni sortent l'album Alegre Me Siento
Kicca & Oscar Marchioni sortent l'album Alegre Me Siento









