Une Russie entre gris clair et gris foncée.
Qui ne connaît le "Premier Concerto pour piano" de Tchaïkovsky? Son introduction musicale a fait les beaux jours d’Hollywood et de certains publicitaires par son aspect technicolor-grand-spectacle approximatif et franchement aguicheur.
Objet d’admiration ou de rejet selon la sensibilité de chacun, cet opus 23 rabâché par tous les stakhanovistes des conservatoires soviétiques, et d’ailleurs, irrite ou séduit, emphatique à souhait mais toujours plein de richesses et de qualités dans sa facture.
Et si la seule possibilité d’éclairer l’œuvre était de la considérer comme un concerto de chambre, où le piano imposerait son style élégant et sophistiqué, s’écoutant d’abord lui-même, avant de condescendre à dialoguer avec les solistes (vents) et les tutti de l’orchestre?
C’est ce que semble nous dire Andrei Korobeinikof et Gian-Luigi Gelmetti. Le toucher du pianiste russe est d’une belle volubilité, et, tout de force de l’artiste, malgré les inévitables effets de manche, les rallentendos, un phrasé à la fois d’une rigueur toute militaire ou parfois très nuancé, nous ne perdons jamais le fil du discours.
Chef et pianiste dans une calme dualité artistique ne sacrifient ni l’exigence technique (qui avait rebuté à la création son dédicataire), ni le sentimentalisme de ce Tchaïkovsky de jeunesse.
Le scherzando médian a cette ductilité diaphane, Gelmetti arrivant à donner au Philharmonique de Monte-Carlo une réplique de la même hauteur de vue.
Plaisir également de retrouver dans le finale "Allegro con fuoco" cette ambiance de kermesse endiablée. Dans cette lutte endiablée entre phalange et soliste, il n’y a ni vaincu, ni vainqueur. Plutôt une réjouissante complicité.
Prokofiev considérait sa "Cinquième Symphonie" comme "l’aboutissement d’une vie de création". Grand succès à sa création en 1945, le public soviétique y voyait, sans doute à juste titre, une allusion aux victoires militaires et politiques qui se profilaient à l’horizon.
Avec ses percussions envahissantes, sa masse orchestrale imposante, son souffle guerrier, son élan glorieux et lumineux, Prokofiev, en fait, propose une lecture tout à fait nouvelle et personnelle de la symphonie.
On attendait un peu au tournant l’actuel directeur artistique et musical dans cette complexe et torturée partition. Sous sa battue si particulière, force est de reconnaître une pâte sonore massive, imposante, une vivacité qui reste toujours un rien ensorcelante.
Toutefois, à la morosité poétiquement bucolique et au patriotisme sournoisement calculé voulus par le compositeur, s’ajoutaient sur scène une curieuse retenue, un recul inhabituel de la phalange.
Dans sa parfaite mise en place à la stéréo tonitruante, mécanique, cette coulée de lave reste froide, ce chapelet de notes diaboliquement parfaites dans leur glaciale beauté émeut à dose homéopathique, tel un manque de vision globale pour une émotion trouble et glauque qui semble plus calculée que véritablement triomphante.
Objet d’admiration ou de rejet selon la sensibilité de chacun, cet opus 23 rabâché par tous les stakhanovistes des conservatoires soviétiques, et d’ailleurs, irrite ou séduit, emphatique à souhait mais toujours plein de richesses et de qualités dans sa facture.
Et si la seule possibilité d’éclairer l’œuvre était de la considérer comme un concerto de chambre, où le piano imposerait son style élégant et sophistiqué, s’écoutant d’abord lui-même, avant de condescendre à dialoguer avec les solistes (vents) et les tutti de l’orchestre?
C’est ce que semble nous dire Andrei Korobeinikof et Gian-Luigi Gelmetti. Le toucher du pianiste russe est d’une belle volubilité, et, tout de force de l’artiste, malgré les inévitables effets de manche, les rallentendos, un phrasé à la fois d’une rigueur toute militaire ou parfois très nuancé, nous ne perdons jamais le fil du discours.
Chef et pianiste dans une calme dualité artistique ne sacrifient ni l’exigence technique (qui avait rebuté à la création son dédicataire), ni le sentimentalisme de ce Tchaïkovsky de jeunesse.
Le scherzando médian a cette ductilité diaphane, Gelmetti arrivant à donner au Philharmonique de Monte-Carlo une réplique de la même hauteur de vue.
Plaisir également de retrouver dans le finale "Allegro con fuoco" cette ambiance de kermesse endiablée. Dans cette lutte endiablée entre phalange et soliste, il n’y a ni vaincu, ni vainqueur. Plutôt une réjouissante complicité.
Prokofiev considérait sa "Cinquième Symphonie" comme "l’aboutissement d’une vie de création". Grand succès à sa création en 1945, le public soviétique y voyait, sans doute à juste titre, une allusion aux victoires militaires et politiques qui se profilaient à l’horizon.
Avec ses percussions envahissantes, sa masse orchestrale imposante, son souffle guerrier, son élan glorieux et lumineux, Prokofiev, en fait, propose une lecture tout à fait nouvelle et personnelle de la symphonie.
On attendait un peu au tournant l’actuel directeur artistique et musical dans cette complexe et torturée partition. Sous sa battue si particulière, force est de reconnaître une pâte sonore massive, imposante, une vivacité qui reste toujours un rien ensorcelante.
Toutefois, à la morosité poétiquement bucolique et au patriotisme sournoisement calculé voulus par le compositeur, s’ajoutaient sur scène une curieuse retenue, un recul inhabituel de la phalange.
Dans sa parfaite mise en place à la stéréo tonitruante, mécanique, cette coulée de lave reste froide, ce chapelet de notes diaboliquement parfaites dans leur glaciale beauté émeut à dose homéopathique, tel un manque de vision globale pour une émotion trouble et glauque qui semble plus calculée que véritablement triomphante.
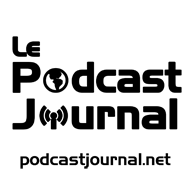











 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








