Henri Amouroux (1920-2007), qui fut membre de l’Académie des sciences morales et politiques, a laissé une œuvre monumentale sur les Années Noires, La Grande Histoire des Français sous l’Occupation. Elle comporte plusieurs volumes publiés dans la collection Bouquins aux Éditions Robert Laffont.
Dans le premier volume sont évoqués les événements de mai-juin 1940 dont Canal Académie vous propose des extraits en lecture. Ce ne sont bien sûr que des extraits ; pour comprendre l’enchaînement des faits et les sentiments, les sensations, le ressenti de la population française tels qu’Amouroux a su les décrire, il faut lire tout l’ouvrage.
Après avoir examiné la vie quotidienne des Français en 1939, des Français qui ne s’aiment pas – c’est le temps des disputes et des haines -, qui ne font plus d’enfants, qui sont largement au chômage, après avoir évoqué la « Drôle de guerre » et examiné aussi l’état de l’armée française, mal équipée, l’auteur aborde la débâcle.
On est le 10 mai 40 à l’aube. Ils arrivent. Qui ? les avions, les stukas qui vont faire que le ciel va tomber sur la tête des Français.
« Ils arrivent. Ils arrivent les avions annoncés par Fernand Robbe. Ils arrivent avec leurs bombes, leurs mitrailleuses. Et leurs sirènes. Piquant sur ces soldats français, braves, râleurs, inscouciants... Alors "nous nous terrons, misérablement recroquevillés". Ils se terrent, c’est vrai... C’est vrai surtout dans les premiers jours, lorsque tout est neuf dans cette guerre où l’on ne sait ni comment se protéger, ni comment lutter contre ce danger qui dégringole du ciel, ce danger personnalisé, cet adversaire énorme... Les bombes bouleversent les abris, renversent les batteries, tuent ou affolent les chevaux, détruisent les liaisons téléphoniques, retardent l’arrivée des renforts et surtout ruinent les âmes... »
Dans le premier volume sont évoqués les événements de mai-juin 1940 dont Canal Académie vous propose des extraits en lecture. Ce ne sont bien sûr que des extraits ; pour comprendre l’enchaînement des faits et les sentiments, les sensations, le ressenti de la population française tels qu’Amouroux a su les décrire, il faut lire tout l’ouvrage.
Après avoir examiné la vie quotidienne des Français en 1939, des Français qui ne s’aiment pas – c’est le temps des disputes et des haines -, qui ne font plus d’enfants, qui sont largement au chômage, après avoir évoqué la « Drôle de guerre » et examiné aussi l’état de l’armée française, mal équipée, l’auteur aborde la débâcle.
On est le 10 mai 40 à l’aube. Ils arrivent. Qui ? les avions, les stukas qui vont faire que le ciel va tomber sur la tête des Français.
« Ils arrivent. Ils arrivent les avions annoncés par Fernand Robbe. Ils arrivent avec leurs bombes, leurs mitrailleuses. Et leurs sirènes. Piquant sur ces soldats français, braves, râleurs, inscouciants... Alors "nous nous terrons, misérablement recroquevillés". Ils se terrent, c’est vrai... C’est vrai surtout dans les premiers jours, lorsque tout est neuf dans cette guerre où l’on ne sait ni comment se protéger, ni comment lutter contre ce danger qui dégringole du ciel, ce danger personnalisé, cet adversaire énorme... Les bombes bouleversent les abris, renversent les batteries, tuent ou affolent les chevaux, détruisent les liaisons téléphoniques, retardent l’arrivée des renforts et surtout ruinent les âmes... »
Maintenant, nous sommes le 16 mai. Moins d’une semaine après l’assaut allemand. Très vite, Paris est sensibilisé à l’exode. De ce jeudi 16 mai, le Ministre de l’Information, Frossard, dira que ce fut « la journée verdâtre ». Journée de la peur inscrite, visible, lisible sur les visages d’hommes qui, jusque là, avaient cru à la victoire. « L’une des plus tristes journées de toute l’histoire de France », écrit Henri Amouroux. Les réfugiés vont donc fuir, et s’élancer vers les routes du Sud. La fuite, tel est titre qu’Henri Amouroux donne à ce chapitre 11. Il y parle, à nouveau, de l’importance des avions :
« En mai 40, les avions ne manquent pas. Les avions allemands bien sûr… Ils arrachent des millions de Belges, puis de Français à leurs maisons, leurs villages, les jettent sur les routes où ils pourront à loisir les saisir, les tourner, les retourner, molle pâte humaine qui s’étale finalement jusque dans l’herbe des fossés... On part donc, d’abord parce que les Allemands bombardent. Impitoyablement. Et que cèdent des abris et des cœurs qui n’ont été qu’imparfaitement préparés à cette nouvelle forme de guerre... Mais comment ne pas être tenté de partir, le 10 mai, lorsqu’avec des dizaines d’aérodromes et de gares, les Allemands atteignent fatalement des dizaines de villes... Comment ne pas partir, lorsque le 14 mai à Tergnier, la gare est écrasée... Comment ne pas partir de Dunkerque où rien n’est épargné ? Comment ne pas fuir Sedan, Charleville, Vouziers et toutes ces villes des Ardennes... Comment ne pas partir de Lille, d’Amiens, d’Arras, de Beauvais ? Partout des cadavres... Les gares bourrées de troupes en transit, d’évacués hagards et las, avides d’atteindre ces havres qui ne sont généralement que des pièges mais où ils espèrent recevoir le pain et l’eau, le secours d’un médecin ou d’une parole charitable, les gares, avec leurs wagons de munitions follement mêlés aux convois humains, sont des proies de choix et des lieux où la tragédie rencontre de quoi s’alimenter... le train par miracle est intact, mais voilà des hommes et des femmes dégoûtés soudain de ce moyen de locomotion. »
« En mai 40, les avions ne manquent pas. Les avions allemands bien sûr… Ils arrachent des millions de Belges, puis de Français à leurs maisons, leurs villages, les jettent sur les routes où ils pourront à loisir les saisir, les tourner, les retourner, molle pâte humaine qui s’étale finalement jusque dans l’herbe des fossés... On part donc, d’abord parce que les Allemands bombardent. Impitoyablement. Et que cèdent des abris et des cœurs qui n’ont été qu’imparfaitement préparés à cette nouvelle forme de guerre... Mais comment ne pas être tenté de partir, le 10 mai, lorsqu’avec des dizaines d’aérodromes et de gares, les Allemands atteignent fatalement des dizaines de villes... Comment ne pas partir, lorsque le 14 mai à Tergnier, la gare est écrasée... Comment ne pas partir de Dunkerque où rien n’est épargné ? Comment ne pas fuir Sedan, Charleville, Vouziers et toutes ces villes des Ardennes... Comment ne pas partir de Lille, d’Amiens, d’Arras, de Beauvais ? Partout des cadavres... Les gares bourrées de troupes en transit, d’évacués hagards et las, avides d’atteindre ces havres qui ne sont généralement que des pièges mais où ils espèrent recevoir le pain et l’eau, le secours d’un médecin ou d’une parole charitable, les gares, avec leurs wagons de munitions follement mêlés aux convois humains, sont des proies de choix et des lieux où la tragédie rencontre de quoi s’alimenter... le train par miracle est intact, mais voilà des hommes et des femmes dégoûtés soudain de ce moyen de locomotion. »
On fuit donc. Et Henri Amouroux, dans sa description de cet exode de mai-juin 40, selon sa manière habituelle – n’oublions pas qu’il veut décrire la vie quotidienne des Français – entre dans les détails. Comment part-on ? À pied. Ou en train ? Mais comment paie-t-on ? Avec quel argent ? Pourquoi partir ? Est-ce par peur ? Et qui part, les riches ? Les pauvres ? Y-a-t-il une hiérarchie dans les départs ? Écoutez sur toutes ces interrogations, ce qu’écrit Henri Amouroux qui a recueilli des centaines et des centaines de témoignages.
« Pourquoi partir alors que des villages ne paraissent nullement menacés, que le flot de l’invasion les néglige ? La peur ? Oui. Mais on part également parce que l’ordre a été donné par des autorités qui veulent soustraire le maximum de mobilisables et d’ouvriers à l’envahisseur... On part donc aussi par patriotisme. Pour rejoindre "l’autre côté" de la France, franchir ce fleuve - Somme, Marne, Seine, Loire - qui n’est pas encore un nom de victoire mais où, nul n’en doute, l’armée française finira bien par arrêter et vaincre l’ennemi... Ils se joindront au flot qui encombre toutes les routes, au flot des guimbardes, des autos au toit gonflé de malles, de valises, de paquets solidement arrimés, au flot des charrettes paysannes entourées encore des odeurs et des bruits de la ferme, au flot des piétons avec leur couverture rouge en bandoulière, leur sac à dos, leur mauvaises valises de carton à la main... Fleuve humain (2 millions, 3 millions, on ne saura jamais exactement combien de Belges) mais dont toutes les motivations ne sont pas uniquement dictées par la frousse. On ne veut pas devenir allemand. »
« Pourquoi partir alors que des villages ne paraissent nullement menacés, que le flot de l’invasion les néglige ? La peur ? Oui. Mais on part également parce que l’ordre a été donné par des autorités qui veulent soustraire le maximum de mobilisables et d’ouvriers à l’envahisseur... On part donc aussi par patriotisme. Pour rejoindre "l’autre côté" de la France, franchir ce fleuve - Somme, Marne, Seine, Loire - qui n’est pas encore un nom de victoire mais où, nul n’en doute, l’armée française finira bien par arrêter et vaincre l’ennemi... Ils se joindront au flot qui encombre toutes les routes, au flot des guimbardes, des autos au toit gonflé de malles, de valises, de paquets solidement arrimés, au flot des charrettes paysannes entourées encore des odeurs et des bruits de la ferme, au flot des piétons avec leur couverture rouge en bandoulière, leur sac à dos, leur mauvaises valises de carton à la main... Fleuve humain (2 millions, 3 millions, on ne saura jamais exactement combien de Belges) mais dont toutes les motivations ne sont pas uniquement dictées par la frousse. On ne veut pas devenir allemand. »
Quant aux personnes qui occupent des fonctions officielles, certaines désertent leur poste ; d’autres tentent de résister…
« On tire un fil et tout se défait… Les pompiers s’en vont avec le reste de la population. Les magistrsats municipaux abandonnent leur postes... On ne sait plus s’il est courageux ou lâche de partir. Courageux ou lâche de rester. ... À Nancy, les épreuves du baccalauréat ont commencé le 14 juin. ...Témoignage extrême de la brutalité de la catastrophe comme de l’incroyable optimisme de tout un peuple. »
Le paysan, lui, voudrait au moins sauver ce qui représente sa seule richesse, ses seuls biens, le bétail :
« Lorsqu’un pays entier prend la fuite, les habitants saisissent non toujours l’indispensable mais ce qui leur tombe sous la main.... L’exode de 40 restera celui des piétons surchargés, des cyclistes et des paysans sur ces lourdes, lentes, majestueuses charrettes faites pour ramasser les gerbes ou les betteraves qui iront porter témoignage que, jusque dans la plus humble des fermes, la France entière a été touchée. Beaucoup de départs sont improvisés... Qui dira l’effroyable spectacle des bêtes abandonnées dans des villes abandonnées ? Chats et chiens errants, affamés... »
Et à Paris, pendant ce temps, que se passe-t-il ? Au chapitre 12, Henri Amouroux titre "Le silence de Paris".
« À Paris, le mécanisme de l’exode officiel se déclenche dans l’après-midi du 9 juin. On a beau recommander aux officiels de partir avec le maximum de discrétion, donc nuitamment, la ville dort mal, sensible aux plus légers bruits de moteurs. C’est pourtant pendant la nuit qu’il faut s’éloigner si l’on veut éviter les embouteillages aux portes. C’est ainsi que Jeanneney, qui a quitté le Sénat le 10 juin à 3 h 45, avec quatre voitures... arrive sans encombre à Arpajon... à Tours à 9 h 15 après s’être arrêté à Blois pour le petit déjeuner, ce qui, compte tenu du malheur des temps, représente presque un exploit… Lorsque le 10 juin, Paul Raynaud décide, à son tour, de partir, il est 10 heures du soir. Il s’éloigne presque clandestinement accompagné du seul général de Gaulle... Raynaud, De Gaulle et Villelume arriveront à Orléans après trois heures et demie de voyage. »
« On tire un fil et tout se défait… Les pompiers s’en vont avec le reste de la population. Les magistrsats municipaux abandonnent leur postes... On ne sait plus s’il est courageux ou lâche de partir. Courageux ou lâche de rester. ... À Nancy, les épreuves du baccalauréat ont commencé le 14 juin. ...Témoignage extrême de la brutalité de la catastrophe comme de l’incroyable optimisme de tout un peuple. »
Le paysan, lui, voudrait au moins sauver ce qui représente sa seule richesse, ses seuls biens, le bétail :
« Lorsqu’un pays entier prend la fuite, les habitants saisissent non toujours l’indispensable mais ce qui leur tombe sous la main.... L’exode de 40 restera celui des piétons surchargés, des cyclistes et des paysans sur ces lourdes, lentes, majestueuses charrettes faites pour ramasser les gerbes ou les betteraves qui iront porter témoignage que, jusque dans la plus humble des fermes, la France entière a été touchée. Beaucoup de départs sont improvisés... Qui dira l’effroyable spectacle des bêtes abandonnées dans des villes abandonnées ? Chats et chiens errants, affamés... »
Et à Paris, pendant ce temps, que se passe-t-il ? Au chapitre 12, Henri Amouroux titre "Le silence de Paris".
« À Paris, le mécanisme de l’exode officiel se déclenche dans l’après-midi du 9 juin. On a beau recommander aux officiels de partir avec le maximum de discrétion, donc nuitamment, la ville dort mal, sensible aux plus légers bruits de moteurs. C’est pourtant pendant la nuit qu’il faut s’éloigner si l’on veut éviter les embouteillages aux portes. C’est ainsi que Jeanneney, qui a quitté le Sénat le 10 juin à 3 h 45, avec quatre voitures... arrive sans encombre à Arpajon... à Tours à 9 h 15 après s’être arrêté à Blois pour le petit déjeuner, ce qui, compte tenu du malheur des temps, représente presque un exploit… Lorsque le 10 juin, Paul Raynaud décide, à son tour, de partir, il est 10 heures du soir. Il s’éloigne presque clandestinement accompagné du seul général de Gaulle... Raynaud, De Gaulle et Villelume arriveront à Orléans après trois heures et demie de voyage. »
Et Paris va capituler. Les Allemands entrent dans la capitale dans la matinée du 14 juin.
« À Paris, où ne restent plus, le 13, que les reliefs de l’exode, comme si quelque poubelle géante s’était déversée sur toute la ville, à Paris, où les rares passants constatent, comme le fait Paul Léautaud, que le Louvre n’est plus gardé... les Allemands entrent dans la matinée du 14 juin, vers 7 h 30 du matin... Paris a capitulé… Sur leur passage, les Allemands font décrocher les drapeaux français flottant à l’entrée de quelques ministères, vont aux Invalides réclamer au général Dentz la restitution des étendards que nous avions pris au cours de la précédente guerres, et hissent sur les bâtiments qu’ils occupent, le drapeau à croix gammée... Une ville où aucun monument n’a été détruit, aux rues vides, aux larges avenues silencieuses, aux promenades sans public, merveilleux décor déserté par presque tous ses acteurs familiers. »
Si l’on regarde les chiffres, peut-on estimer le nombre de réfugiés ? Henri Amouroux, selon sa méthode d’investigation précise et foncièrement honnête, se méfie des chiffres soi-disant officiels…
« Combien de réfugiés ? Nul, jamais, ne pourra exactement donner un chiffre. Dans la pagaille de juin, les statistiques sont impossibles à tenir. D’ailleurs, les réfugiés vont et viennent ballottés par le drame... Tout demeure approximatif... Alors, pour la France, 8 ou 10 millions de réfugiés ? Qu’importe ! Ce qui compte, c’est qu’ils sont la FOULE impressionnante, anonyme, bouleversée, ne contrôlant plus ses gestes, évadée de toute raison, prisonnière de toutes les folies, grisée de rumeurs fausses et de terreurs vraies, se bousculant sur les routes de l’espoir, toutes classes sociales confondues, ce qui ne veut nullement dire que du grand brassage de juin naîtront compréhension et solidarité. La foule, soudain ramenée à l’essentiel et à l’élémentaire : le pain, le toit. Et la vie sauve... Foule pieuvre.... La foule pesante.... Foule qui joue un rôle capital dans la tragédie française. »
Les lectures sont assurées par le comédien Fernand Guiot.
« À Paris, où ne restent plus, le 13, que les reliefs de l’exode, comme si quelque poubelle géante s’était déversée sur toute la ville, à Paris, où les rares passants constatent, comme le fait Paul Léautaud, que le Louvre n’est plus gardé... les Allemands entrent dans la matinée du 14 juin, vers 7 h 30 du matin... Paris a capitulé… Sur leur passage, les Allemands font décrocher les drapeaux français flottant à l’entrée de quelques ministères, vont aux Invalides réclamer au général Dentz la restitution des étendards que nous avions pris au cours de la précédente guerres, et hissent sur les bâtiments qu’ils occupent, le drapeau à croix gammée... Une ville où aucun monument n’a été détruit, aux rues vides, aux larges avenues silencieuses, aux promenades sans public, merveilleux décor déserté par presque tous ses acteurs familiers. »
Si l’on regarde les chiffres, peut-on estimer le nombre de réfugiés ? Henri Amouroux, selon sa méthode d’investigation précise et foncièrement honnête, se méfie des chiffres soi-disant officiels…
« Combien de réfugiés ? Nul, jamais, ne pourra exactement donner un chiffre. Dans la pagaille de juin, les statistiques sont impossibles à tenir. D’ailleurs, les réfugiés vont et viennent ballottés par le drame... Tout demeure approximatif... Alors, pour la France, 8 ou 10 millions de réfugiés ? Qu’importe ! Ce qui compte, c’est qu’ils sont la FOULE impressionnante, anonyme, bouleversée, ne contrôlant plus ses gestes, évadée de toute raison, prisonnière de toutes les folies, grisée de rumeurs fausses et de terreurs vraies, se bousculant sur les routes de l’espoir, toutes classes sociales confondues, ce qui ne veut nullement dire que du grand brassage de juin naîtront compréhension et solidarité. La foule, soudain ramenée à l’essentiel et à l’élémentaire : le pain, le toit. Et la vie sauve... Foule pieuvre.... La foule pesante.... Foule qui joue un rôle capital dans la tragédie française. »
Les lectures sont assurées par le comédien Fernand Guiot.

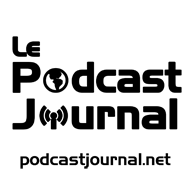









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








