0:00
0:00
On ne sort que rarement indemne d'une représentation d'Elektra. Cette épopée de feu et de sang, au souffle putride, cette folie assumée d'une antiquité crûment et sadiquement fantasmée (Strauss a écrit "Elektra" juste après "Salomé" qui a été aussi une bombe en son temps), à la sensualité morbide, entre hargne, démesure et fureur, mythiquement titanesque, vous cloue sur place et vous tourneboule longtemps après le rideau tombé.
On entre en effet dans une veine absolument expressionniste que Strauss ne retrouvera plus dans ses opéras suivants. Une fois encore, il illustre à merveille la violence de son livret, dans un écrin orchestral somptueux qui ouvre par moments la porte à l'atonalité. Ici peut sans craindre de déranger les voisins hurler la douleur de l’absence, et danser la rage de la vengeance accomplie, en un ultime élan de vie. On assiste, par le petit bout de la lorgnette, aux déchirements des Atrides, à la lueur d'une conscience nouvelle placée sous l'influence de nouveaux préceptes issus des théories freudiennes.
Bien connue des Marseillais, la production signée voici dix ans par Charles Roubaud a donc repris du service. L’imposant décor d’Emmanuel Favre a gardé, dans sa glaciale perspective, son impact d’ivresse abyssale ou vertigineuse et les costumes de Katia Duflot nous transportent toujours dans un milieu petit bourgeois bon chic bon genre, mais ici plein de blessures perversement assassines.
Au risque de se répéter, voilà une Elektra hors des temps et des mondes, qui malgré les serpillères des servantes restera de bout en bout un espace putride, pourri, violent, abject, immonde poubelle terrifiante, un cauchemar vivant, bref, les Enfers, où l’héroïne sera la seule à rester lucide même à travers sa folie meurtrière.
On le sait. Chez Strauss ce sont les voix féminines qui sont à l'honneur. Et de manière grandiose!
Jeanne-Michèle Charbonnet a une incontestable présence vocale et scénique, une compréhension du rôle indéniable. Une fois digérés un vibrato à deux vitesses, et des aigus un rien plafonnés, la belle Américaine captive avec des silences dans le regard qui en disent long, ces gestes de tous les jours ou cette danse finale, dans un voile de deuil plus que de mariée, simplifiée à l’extrême.
Intense confrontation - on s’en doutait un peu - avec la Klytemnestre de Marie-Ange Todorovitch.
A l’aise dans le granit vocal de ce rôle terrifiant, ruine morale plus que physique, sorte de Jézabel biblique, la Montpelliéraine captive ne vous lâche pas, vous prend aux tripes. On sent le travail sur le texte et le personnage. Fascinante Prima Donna.
Face à ces deux chanteuses hors format, Ricarda Merbeth, leur soufflerait presque la vedette avec une Chrysothémis bourrée de décibels, sensuelle comme pas deux dans ses bouffées de chaleur, hyperlyrique dans ses montées hormonales frustrées.
Patrick Raftery (Aegisth) et Nicolas Cavalier (Oreste à la mezza voce accablée de tendresse) sont plus que convaincants malgré la brièveté de leur partie. Deux silhouettes croquées avec finesse, bien en place. Tout comme les autres petits rôles, et ils sont nombreux, qui font ici plus que de la figuration intelligente chantée.
La rigueur de la direction raffinée de Pinchas Steinberg distille sang, angoisse et haine, telle une navigation houleuse dans les méandres de la psychanalyse. L’Orchestre de l’Opéra de Marseille, transfiguré, dans le murmure comme dans l’ivresse sonore, chauffé à blanc au début puis porté à l’incandescence, transpire cette apocalyptique musique de fin de monde dans une orgie rugissante, une opulence du tissu orchestral qui laisse pantois.
On entre en effet dans une veine absolument expressionniste que Strauss ne retrouvera plus dans ses opéras suivants. Une fois encore, il illustre à merveille la violence de son livret, dans un écrin orchestral somptueux qui ouvre par moments la porte à l'atonalité. Ici peut sans craindre de déranger les voisins hurler la douleur de l’absence, et danser la rage de la vengeance accomplie, en un ultime élan de vie. On assiste, par le petit bout de la lorgnette, aux déchirements des Atrides, à la lueur d'une conscience nouvelle placée sous l'influence de nouveaux préceptes issus des théories freudiennes.
Bien connue des Marseillais, la production signée voici dix ans par Charles Roubaud a donc repris du service. L’imposant décor d’Emmanuel Favre a gardé, dans sa glaciale perspective, son impact d’ivresse abyssale ou vertigineuse et les costumes de Katia Duflot nous transportent toujours dans un milieu petit bourgeois bon chic bon genre, mais ici plein de blessures perversement assassines.
Au risque de se répéter, voilà une Elektra hors des temps et des mondes, qui malgré les serpillères des servantes restera de bout en bout un espace putride, pourri, violent, abject, immonde poubelle terrifiante, un cauchemar vivant, bref, les Enfers, où l’héroïne sera la seule à rester lucide même à travers sa folie meurtrière.
On le sait. Chez Strauss ce sont les voix féminines qui sont à l'honneur. Et de manière grandiose!
Jeanne-Michèle Charbonnet a une incontestable présence vocale et scénique, une compréhension du rôle indéniable. Une fois digérés un vibrato à deux vitesses, et des aigus un rien plafonnés, la belle Américaine captive avec des silences dans le regard qui en disent long, ces gestes de tous les jours ou cette danse finale, dans un voile de deuil plus que de mariée, simplifiée à l’extrême.
Intense confrontation - on s’en doutait un peu - avec la Klytemnestre de Marie-Ange Todorovitch.
A l’aise dans le granit vocal de ce rôle terrifiant, ruine morale plus que physique, sorte de Jézabel biblique, la Montpelliéraine captive ne vous lâche pas, vous prend aux tripes. On sent le travail sur le texte et le personnage. Fascinante Prima Donna.
Face à ces deux chanteuses hors format, Ricarda Merbeth, leur soufflerait presque la vedette avec une Chrysothémis bourrée de décibels, sensuelle comme pas deux dans ses bouffées de chaleur, hyperlyrique dans ses montées hormonales frustrées.
Patrick Raftery (Aegisth) et Nicolas Cavalier (Oreste à la mezza voce accablée de tendresse) sont plus que convaincants malgré la brièveté de leur partie. Deux silhouettes croquées avec finesse, bien en place. Tout comme les autres petits rôles, et ils sont nombreux, qui font ici plus que de la figuration intelligente chantée.
La rigueur de la direction raffinée de Pinchas Steinberg distille sang, angoisse et haine, telle une navigation houleuse dans les méandres de la psychanalyse. L’Orchestre de l’Opéra de Marseille, transfiguré, dans le murmure comme dans l’ivresse sonore, chauffé à blanc au début puis porté à l’incandescence, transpire cette apocalyptique musique de fin de monde dans une orgie rugissante, une opulence du tissu orchestral qui laisse pantois.
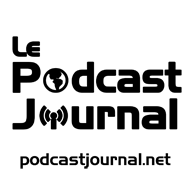









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark









