Couronnement de Jean-François Lapointe
La boutade d'Emmanuel Chabrier est connue: "Il y a la bonne, la mauvaise musique et celle d'Ambroise Thomas". Il ne serait pas injuste de juger, avec une certaine condescendance, la partition du compositeur de Mignon. Un tantinet de science pour mettre les voix en valeur, quelques mélodies flatteuses, une suite d'airs, d'ensembles, de chansons à boire et de ballets avec "air de la folie" obligatoire ... pour souvent hélas un no man's land naviguant entre relents verdiens, une touche d'Offenbach, un soupçon de Meyerbeer ou Gounod... Même une chatte n'y trouverait pas ses petits...
Ne cherchons surtout pas ici la profondeur du drame shakespearien, le héros monte à la fin sur le trône de son défunt père! Il existe paraît-il une variante italienne, donnée à Londres plus tard, qui prend fin avec le suicide du plus célèbre névrosé du Danemark. A vous de la trouver.
La carrière brillante que connut cet "Hamlet" en 1868, date de sa création, jusqu'à la fin du premier quart de siècle, prouve indubitablement qu'aujourd'hui le public attend autre chose.
A peine une demi-salle en cette première marseillaise, et en comptant large... Vox Populi, Vox Dei?
Et pourtant, encore une fois les absents ont eu tort. Tout simplement car la production de Vincent Boussard (Duflot et Levi aux costumes et éclairages) est exemplaire en originalité, théâtralité, modernité (en six ans, pas une ride à ce spectacle) et que ce génial metteur en scène, par de saisissantes touches acrobatiques, quelques regards, en enfonçant la tradition mais en respectant le parcours psychologique des personnages, frise le génie. Si la musique de Thomas fait souvent sourire, son travail sur le fond et la forme impose respect et admiration.
Tout comme la prestation de Jean-François Lapointe. Maîtrisant parfaitement un des rôles les plus brillants du répertoire de baryton, avec, cerise sur le gâteau, ce ton métallique, cette noire mélancolie, comment ne pas rester confondu d'admiration devant sa prestation, tant elle se joue avec une virtuosité admirable des difficultés d'une partition qui exige de son titulaire souplesse, étendue vocale, âpreté?
En prime, ce mordant charbonneux qui donne au personnage sa nostalgie douloureuse, sa dureté attendrie. Jean-François Lapointe? Le Gérard Philipe de l'opéra!
Parfois un rien molle de diction, Patrizia Ciofi, accrochant la lumière avec classe et grâce, apporte à son Ophélie le prestige d'une voix qui conserve sa pureté anguleuse, son éclatante beauté, alliée à une technique éblouissante, une musicalité sans reproche.
On reste aussi baba devant la Gertude de Sylvie Brunet-Grupposo, dont le timbre rappelle celui d'une Denise Scharley. En tragédienne accomplie, la belle artiste apporte en plus un beau frémissement intérieur à cet être torturé par le remord et la crainte.
Les autres rôles sont plus conventionnels. Antoine Garcin (percutant, bien en place en fossoyeur glaçant plus vrai que nature), Jean-Marie Delpas (le Raimu du lyrique dont on ne saurait se passer!) et leurs confrères, mais avec ici et là plus ou moins de bonheur en ce soir de première caniculaire, faisaient toutefois preuve d'un bel esprit d'équipe et campaient plus que des silhouettes de carton découpé.
Il faut être Lawrence Foster pour nous faire croire à l'impossible. Sa direction est encore une fois chatoyante, pleine de souffle héroïque et parvient, dans un parfait équilibre voix-plateau à conserver à l'ouvrage son style propre. Qui pour certains se cherche encore...
Ne cherchons surtout pas ici la profondeur du drame shakespearien, le héros monte à la fin sur le trône de son défunt père! Il existe paraît-il une variante italienne, donnée à Londres plus tard, qui prend fin avec le suicide du plus célèbre névrosé du Danemark. A vous de la trouver.
La carrière brillante que connut cet "Hamlet" en 1868, date de sa création, jusqu'à la fin du premier quart de siècle, prouve indubitablement qu'aujourd'hui le public attend autre chose.
A peine une demi-salle en cette première marseillaise, et en comptant large... Vox Populi, Vox Dei?
Et pourtant, encore une fois les absents ont eu tort. Tout simplement car la production de Vincent Boussard (Duflot et Levi aux costumes et éclairages) est exemplaire en originalité, théâtralité, modernité (en six ans, pas une ride à ce spectacle) et que ce génial metteur en scène, par de saisissantes touches acrobatiques, quelques regards, en enfonçant la tradition mais en respectant le parcours psychologique des personnages, frise le génie. Si la musique de Thomas fait souvent sourire, son travail sur le fond et la forme impose respect et admiration.
Tout comme la prestation de Jean-François Lapointe. Maîtrisant parfaitement un des rôles les plus brillants du répertoire de baryton, avec, cerise sur le gâteau, ce ton métallique, cette noire mélancolie, comment ne pas rester confondu d'admiration devant sa prestation, tant elle se joue avec une virtuosité admirable des difficultés d'une partition qui exige de son titulaire souplesse, étendue vocale, âpreté?
En prime, ce mordant charbonneux qui donne au personnage sa nostalgie douloureuse, sa dureté attendrie. Jean-François Lapointe? Le Gérard Philipe de l'opéra!
Parfois un rien molle de diction, Patrizia Ciofi, accrochant la lumière avec classe et grâce, apporte à son Ophélie le prestige d'une voix qui conserve sa pureté anguleuse, son éclatante beauté, alliée à une technique éblouissante, une musicalité sans reproche.
On reste aussi baba devant la Gertude de Sylvie Brunet-Grupposo, dont le timbre rappelle celui d'une Denise Scharley. En tragédienne accomplie, la belle artiste apporte en plus un beau frémissement intérieur à cet être torturé par le remord et la crainte.
Les autres rôles sont plus conventionnels. Antoine Garcin (percutant, bien en place en fossoyeur glaçant plus vrai que nature), Jean-Marie Delpas (le Raimu du lyrique dont on ne saurait se passer!) et leurs confrères, mais avec ici et là plus ou moins de bonheur en ce soir de première caniculaire, faisaient toutefois preuve d'un bel esprit d'équipe et campaient plus que des silhouettes de carton découpé.
Il faut être Lawrence Foster pour nous faire croire à l'impossible. Sa direction est encore une fois chatoyante, pleine de souffle héroïque et parvient, dans un parfait équilibre voix-plateau à conserver à l'ouvrage son style propre. Qui pour certains se cherche encore...
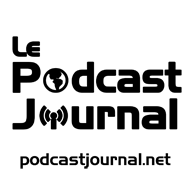











 Louis Arlette voit des élephants avec le clip de Ganesha
Louis Arlette voit des élephants avec le clip de Ganesha








