C'est parfois dur une messe sans la foi

© Photo Auguin
Oeuvre préférée de Hitler, messe sacrée pour tout wagnérien qui se respecte, d’un ridicule achevé pour les agnostiques, inconvenante pour les croyants intégristes, « singerie inconsciente du rite religieux » selon Igor Stravinsky, Parsifal mélange allégrement ésotérisme, geste chevaleresque et religion chrétienne dans un interminable fatras mystico-moralisateur qui nous narre - en fond sonore plus de quatre heures de musique ! – encore une fois le mythe du héros rédempteur.
Arracher donc cette mélopée dolente qu’est Parsifal à sa léthargie philosophique et touffue, lui donner du nerf, souligner chaque détail d’une orchestration raffinée, il fallait le faire, le metteur en scène et décorateur helvétique Richard Aeschlimann, l’a fait, proprement, avec même une réelle originalité mais sans vraie spiritualité.
Tout simplement en racontant ce mystère sacré à la bondieuserie démentielle sans trop chercher midi à quatorze heures, dans une suite de tableaux animés, (costumes de Suzanne Raschig), par ailleurs magnifiquement éclairés, aux couleurs vives, que l’on dirait copiés sur les meilleures productions en technicolor et son dolby stéréo importées d’Hollywood.
Dans ce désir de dépoussiérage salvateur, il manque d’un rien de respect à la lettre aux intentions du teuton compositeur, le plus génialement déjanté de sa génération.
Aeschlimann laisse donc au placard à balais ses recommandations scéniques ou théâtrales et nous propose un film de capes et d’épées futuriste, une heroic fantasy new age aux images parfois bien revêches à la partition. Là le bât a blessé plus d’une fois.
Présenter le Saint Graal comme une sorte de boite à chaussures design pouvait se révéler drôle, mais lorsque la musique appelle la lumière, ce polyèdre étrange et suspendu dans les airs, sorti d’une bouche béante d’égout ou d’un cœur de centrale nucléaire, reste trop terne, sombre, sans vie. Le propos un temps novateur tombe alors à plat.
Bien peu d’élévation spirituelle aussi, de frisson, dans l’Enchantement du Vendredi-Saint. Sans doute par souci d’oecuménisme, à trop désacraliser, le metteur en scène s’enlise finalement dans l’hérésie décorative voire le ridicule achevé, tel ce tableau ultime de Pietà " alla " Michel-Ange renversé…
Parole d’un mécréant venu ici chercher un soir ce rien d’émotion contenue dans une œuvre magistralement suffocante par sa démente démesure, au propos rébarbatif, mais dont il ne saurait se passer…
Dieu que c’est dur une messe quand on n’a pas la foi !
On pouvait dès lors s’extasier sur les restes vocaux glorieux de Kurt Rydl, louer son intelligence du texte, du geste, son sens des nuances, la tragique noblesse de son Gurnemanz.
Grandioses également les lamentations lyriques et torrentielles de Jukka Rasileinen en Amfortas très Christ de Passion. Cauteleux et retors à souhait le Klingsor épisodique de Peter Sidhom.
Dans le rôle titre Gary Lehman, déguisé en Simbad ou Ali Baba, un rien benêt, est la jeunesse même. Sa voix, brut de décoffrage, claironne fièrement.
Elena Zhidkova enfin trouve en Kundry un rôle à la mesure de sa personnalité. Si le registre grave n’est pas exceptionnel, reconnaissons que sa composition est réussie, tour à tour bête sauvage, esclave moralement enchaînée, puis mère ruisselante du lait de la tendresse humaine. Avec parfois ce rien de regard de la Marie-Madeleine pour le supplice du Roi des Rois.
Chœurs masculins impressionnants, Filles-Fleurs un peu moins, chorégraphie un rien empotée, seconds rôles bien en place.
On sait que les parties orchestrales de la partition constituent l’autre intérêt de Parsifal.
Avec un Philarmonique de Nice survolté, en état de grâce, drivé comme pas deux, on a rarement entendu un Wagner aussi plein de rutilances solistes, de sonorités impressionnistes. Sous la direction rapide, nerveuse de Philippe Auguin la cérémonie s’irise de couleurs luxuriantes, inquiétantes, hallucinogènes.
Arracher donc cette mélopée dolente qu’est Parsifal à sa léthargie philosophique et touffue, lui donner du nerf, souligner chaque détail d’une orchestration raffinée, il fallait le faire, le metteur en scène et décorateur helvétique Richard Aeschlimann, l’a fait, proprement, avec même une réelle originalité mais sans vraie spiritualité.
Tout simplement en racontant ce mystère sacré à la bondieuserie démentielle sans trop chercher midi à quatorze heures, dans une suite de tableaux animés, (costumes de Suzanne Raschig), par ailleurs magnifiquement éclairés, aux couleurs vives, que l’on dirait copiés sur les meilleures productions en technicolor et son dolby stéréo importées d’Hollywood.
Dans ce désir de dépoussiérage salvateur, il manque d’un rien de respect à la lettre aux intentions du teuton compositeur, le plus génialement déjanté de sa génération.
Aeschlimann laisse donc au placard à balais ses recommandations scéniques ou théâtrales et nous propose un film de capes et d’épées futuriste, une heroic fantasy new age aux images parfois bien revêches à la partition. Là le bât a blessé plus d’une fois.
Présenter le Saint Graal comme une sorte de boite à chaussures design pouvait se révéler drôle, mais lorsque la musique appelle la lumière, ce polyèdre étrange et suspendu dans les airs, sorti d’une bouche béante d’égout ou d’un cœur de centrale nucléaire, reste trop terne, sombre, sans vie. Le propos un temps novateur tombe alors à plat.
Bien peu d’élévation spirituelle aussi, de frisson, dans l’Enchantement du Vendredi-Saint. Sans doute par souci d’oecuménisme, à trop désacraliser, le metteur en scène s’enlise finalement dans l’hérésie décorative voire le ridicule achevé, tel ce tableau ultime de Pietà " alla " Michel-Ange renversé…
Parole d’un mécréant venu ici chercher un soir ce rien d’émotion contenue dans une œuvre magistralement suffocante par sa démente démesure, au propos rébarbatif, mais dont il ne saurait se passer…
Dieu que c’est dur une messe quand on n’a pas la foi !
On pouvait dès lors s’extasier sur les restes vocaux glorieux de Kurt Rydl, louer son intelligence du texte, du geste, son sens des nuances, la tragique noblesse de son Gurnemanz.
Grandioses également les lamentations lyriques et torrentielles de Jukka Rasileinen en Amfortas très Christ de Passion. Cauteleux et retors à souhait le Klingsor épisodique de Peter Sidhom.
Dans le rôle titre Gary Lehman, déguisé en Simbad ou Ali Baba, un rien benêt, est la jeunesse même. Sa voix, brut de décoffrage, claironne fièrement.
Elena Zhidkova enfin trouve en Kundry un rôle à la mesure de sa personnalité. Si le registre grave n’est pas exceptionnel, reconnaissons que sa composition est réussie, tour à tour bête sauvage, esclave moralement enchaînée, puis mère ruisselante du lait de la tendresse humaine. Avec parfois ce rien de regard de la Marie-Madeleine pour le supplice du Roi des Rois.
Chœurs masculins impressionnants, Filles-Fleurs un peu moins, chorégraphie un rien empotée, seconds rôles bien en place.
On sait que les parties orchestrales de la partition constituent l’autre intérêt de Parsifal.
Avec un Philarmonique de Nice survolté, en état de grâce, drivé comme pas deux, on a rarement entendu un Wagner aussi plein de rutilances solistes, de sonorités impressionnistes. Sous la direction rapide, nerveuse de Philippe Auguin la cérémonie s’irise de couleurs luxuriantes, inquiétantes, hallucinogènes.
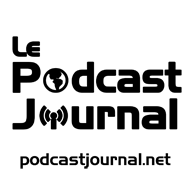









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








