0:00
0:00
C'est dans sa nouvelle salle provisoire, baptisée Opéra Confluence, que la saison lyrique de la cité papale a jeté ses premiers feux. Disons de suite que dans ce grand cadre boisé l'acoustique est irréprochable. Pari risqué donc avec l'Orphée de Glück revisité par Berlioz.
On ne peut vraiment dire que ce soit une œuvre très populaire. Il est même assez rare de la voir à l'affiche dans nos contrées. Curieusement, l'ouvrage a trouvé, dans cette grange assez intime, un éclat particulier. Si l'on ajoute à tout cela que c'est un opéra relativement peu coûteux pour une Maison à inscrire à son répertoire, on peut deviner ici explications à la démarche.
En transposant l'action dans une sorte de "no man's land" charbonneux, sombre comme un jour sans pain, où des panneaux de verre amovibles renvoient le désespoir des âmes (décors et lumières par Hervé Cherblanc), la metteuse en scène Fanny Gioria, aidée par Elza Briand aux costumes, fait du chantre de Thrace un jumeau moderne d'un Werther déchiré très "new age". Plus question ici de mythe ou de demi-dieu mais plutôt un être humain assez proche de nous.
Un parti pris assez discutable mais qui se révèle souvent comme une belle réussite picturale. Les chœurs (irréprochables, homogènes, enthousiastes, recueillis dans leur tenue, nuancés dans leur plénitude), déguisés et coiffés comme une boite de Playmobil de fin de série, et les danseurs, un tantinet acrobatiques, car très "Ballets Béjart", font partie intégrante du drame, personnages à part entière.
Le deuxième acte qui promène le malheureux Orphée entre Furies et Esprits est très "brechtien" dans sa conception. On y croit et c'est l'essentiel.
Dans cette atmosphère démoralisante à souhait (même les héros n'auront pas la fin heureuse espérée), Julie Robard-Gendre, en grande tragédienne, apporte à "Orphée" une caractérisation des plus bouleversantes. Androgyne à souhait, la composition très travaillée est exceptionnelle par son sens du phrasé et ses accents douloureux. De sa voix chaude et cuivrée (qui rappelle irrésistiblement celle de Rita Gorr), sonore, appuyée, vibrée, légèrement poitrinée, la jeune Diva nous a offert un "J'ai perdu mon Eurydice" désolé, déchiré et déchirant, ici traité comme un duo amoureux entre fosse et voix.
Olivia Doray compense un léger manque d'étoffe vocale par une émotion très pure et campe au total un personnage émouvant, tendre, aux grands légatos gorgés de sentiments.
On sera plus réservé pour l'Amour... Qui n'est pas ici un bouquet de violettes... Piquante comme une mouche, Dima Bawab, enjouée, drôle et facétieuse comme un diablotin à ressort de boite à surprise, mais hélas un rien acide... on cherchera en vain, dans son premier air la grande tradition classique de Lully et Rameau dont la page est issue.
Dirigé par Roberto Forès Veses, l'Orchestre Régional Avignon-Provence, quoique assez analytique est d'une lisibilité totale, bien au point et d'un frémissement rare, d'une vérité stylistique entière.
On ne peut vraiment dire que ce soit une œuvre très populaire. Il est même assez rare de la voir à l'affiche dans nos contrées. Curieusement, l'ouvrage a trouvé, dans cette grange assez intime, un éclat particulier. Si l'on ajoute à tout cela que c'est un opéra relativement peu coûteux pour une Maison à inscrire à son répertoire, on peut deviner ici explications à la démarche.
En transposant l'action dans une sorte de "no man's land" charbonneux, sombre comme un jour sans pain, où des panneaux de verre amovibles renvoient le désespoir des âmes (décors et lumières par Hervé Cherblanc), la metteuse en scène Fanny Gioria, aidée par Elza Briand aux costumes, fait du chantre de Thrace un jumeau moderne d'un Werther déchiré très "new age". Plus question ici de mythe ou de demi-dieu mais plutôt un être humain assez proche de nous.
Un parti pris assez discutable mais qui se révèle souvent comme une belle réussite picturale. Les chœurs (irréprochables, homogènes, enthousiastes, recueillis dans leur tenue, nuancés dans leur plénitude), déguisés et coiffés comme une boite de Playmobil de fin de série, et les danseurs, un tantinet acrobatiques, car très "Ballets Béjart", font partie intégrante du drame, personnages à part entière.
Le deuxième acte qui promène le malheureux Orphée entre Furies et Esprits est très "brechtien" dans sa conception. On y croit et c'est l'essentiel.
Dans cette atmosphère démoralisante à souhait (même les héros n'auront pas la fin heureuse espérée), Julie Robard-Gendre, en grande tragédienne, apporte à "Orphée" une caractérisation des plus bouleversantes. Androgyne à souhait, la composition très travaillée est exceptionnelle par son sens du phrasé et ses accents douloureux. De sa voix chaude et cuivrée (qui rappelle irrésistiblement celle de Rita Gorr), sonore, appuyée, vibrée, légèrement poitrinée, la jeune Diva nous a offert un "J'ai perdu mon Eurydice" désolé, déchiré et déchirant, ici traité comme un duo amoureux entre fosse et voix.
Olivia Doray compense un léger manque d'étoffe vocale par une émotion très pure et campe au total un personnage émouvant, tendre, aux grands légatos gorgés de sentiments.
On sera plus réservé pour l'Amour... Qui n'est pas ici un bouquet de violettes... Piquante comme une mouche, Dima Bawab, enjouée, drôle et facétieuse comme un diablotin à ressort de boite à surprise, mais hélas un rien acide... on cherchera en vain, dans son premier air la grande tradition classique de Lully et Rameau dont la page est issue.
Dirigé par Roberto Forès Veses, l'Orchestre Régional Avignon-Provence, quoique assez analytique est d'une lisibilité totale, bien au point et d'un frémissement rare, d'une vérité stylistique entière.
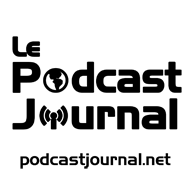











 Qui êtes-vous Andrée Turcy à voir au Guichet Montparnasse dès le 11/04/2025
Qui êtes-vous Andrée Turcy à voir au Guichet Montparnasse dès le 11/04/2025









