UN SPECTACLE SIMPLEMENT PARFAIT

Photo © Christian Dresse
Peu d’œuvres sont aussi délicates que Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss. En invitant la récente production monégasque, le Directeur artistique Maurice Xiberras et sa Conseillère Renée Auphan ont gagné leur pari. Vingt-cinq ans déjà que l’ouvrage n’avait été donné dans la cité phocéenne. Presque une découverte pour certains.
Le spectacle voulu par Dieter Kaegi respectueux à la lettre du livret fourmille d’idées neuves, les décors et costumes un rien kitsch mais toujours somptueux de Bruno Schwengel – un bémol toutefois, l’omniprésente et luxuriante roseraie se justifie seulement au troisième acte - apportent en plus cette touche d’élégance suprême et de sensualité indissociables de la féerique partition.
Seulement voilà, Le Chevalier à la Rose c’est avant tout une atmosphère, ce Zeitgeist dont la belle Maréchale pourrait bien être le fantôme ou le parfum des choses quand celles-ci ont déjà fui. Il y a aussi dans la musique entêtante de Strauss et le livret d’Hoffmansthal une soif de plaisir, de luxe, de volupté qui sont comme les signes d’une civilisation qui court à sa fin.
Cette histoire, prise au pied de la lettre, ne serait qu’une mascarade viennoise bien ficelée, s’il n’y avait au centre de l’intrigue, la Maréchale. C’est elle qui rassemble les forces vives et souterraines de l’œuvre. Elle en est la prime.
Avec Gabriele Fontana nous sommes en présence d’une Maréchale d’exception, délicate, sensible, avec en plus cette nonchalance de l’âme, cette grâce suprême qui sait dépouiller le personnage de tous ses clichés autrichiens pour le hisser au niveau de la métaphore poétique. Pour mieux nous faire découvrir le paysage secret du rôle ?
Jolie composition de Kate Aldrich (l’an passé somptueuse Salammbô sur cette même scène) qui porte le travesti à ravir et retrouve donc sa tessiture originale de mezzo pour camper un impétueux, caracolant et bondissant Octavian qui a enfin la silhouette gracile d’un adolescent. Son chant est de très bon goût, très musical.
Son amoureuse Sophie, la céleste Margareta Klobucar, elle aussi un rien impétueuse (l’amour a ses raisons que la raison ignore), achève de nous séduire. Son père Faninal trouve en Lionel Lhote un baryton de grande classe.
Contraste frappant alors avec Manfred Hemm, qui décape de belle manière son Baron Ochs, un rien vulgaire (mais le rôle ne fait pas dans la dentelle) mais toujours mesuré, parfois caricatural, au volume sonore assez impressionnant.
Le reste du plateau emporte l’adhésion la plus complète. Décernons une mention pour le chanteur italien d’Avi Klemberg et sa musique farcie de clins d’œil assez triviaux (on sait que Strauss n’aimait pas trop les ténors), ou les intrigants Annina/Valzacchi, elle surtout, irrésistible en insinuante Belle de Cadix catapultée dans la Vienne Impériale.
La flopée de petits rôles (notaire, gouvernante, commissaire, acolytes du Baron…) est simplement impeccable.
La complicité et l’intelligence entre l’Orchestre de l’Opéra de Marseille et Philippe Auguin semble s’affirmer de plus en plus. Et ce dès l’ouverture au frémissement réellement réjouissant. La présentation de la rose est comme nimbée d’une féerie de lumière. Partout ailleurs, un élan, une plasticité, une respiration rares. Voilà un Strauss servi au mieux par une équipe jeune et enthousiaste. Un Strauss, qui, une fois encore, increvable, sort victorieux de l’aventure.
Le spectacle voulu par Dieter Kaegi respectueux à la lettre du livret fourmille d’idées neuves, les décors et costumes un rien kitsch mais toujours somptueux de Bruno Schwengel – un bémol toutefois, l’omniprésente et luxuriante roseraie se justifie seulement au troisième acte - apportent en plus cette touche d’élégance suprême et de sensualité indissociables de la féerique partition.
Seulement voilà, Le Chevalier à la Rose c’est avant tout une atmosphère, ce Zeitgeist dont la belle Maréchale pourrait bien être le fantôme ou le parfum des choses quand celles-ci ont déjà fui. Il y a aussi dans la musique entêtante de Strauss et le livret d’Hoffmansthal une soif de plaisir, de luxe, de volupté qui sont comme les signes d’une civilisation qui court à sa fin.
Cette histoire, prise au pied de la lettre, ne serait qu’une mascarade viennoise bien ficelée, s’il n’y avait au centre de l’intrigue, la Maréchale. C’est elle qui rassemble les forces vives et souterraines de l’œuvre. Elle en est la prime.
Avec Gabriele Fontana nous sommes en présence d’une Maréchale d’exception, délicate, sensible, avec en plus cette nonchalance de l’âme, cette grâce suprême qui sait dépouiller le personnage de tous ses clichés autrichiens pour le hisser au niveau de la métaphore poétique. Pour mieux nous faire découvrir le paysage secret du rôle ?
Jolie composition de Kate Aldrich (l’an passé somptueuse Salammbô sur cette même scène) qui porte le travesti à ravir et retrouve donc sa tessiture originale de mezzo pour camper un impétueux, caracolant et bondissant Octavian qui a enfin la silhouette gracile d’un adolescent. Son chant est de très bon goût, très musical.
Son amoureuse Sophie, la céleste Margareta Klobucar, elle aussi un rien impétueuse (l’amour a ses raisons que la raison ignore), achève de nous séduire. Son père Faninal trouve en Lionel Lhote un baryton de grande classe.
Contraste frappant alors avec Manfred Hemm, qui décape de belle manière son Baron Ochs, un rien vulgaire (mais le rôle ne fait pas dans la dentelle) mais toujours mesuré, parfois caricatural, au volume sonore assez impressionnant.
Le reste du plateau emporte l’adhésion la plus complète. Décernons une mention pour le chanteur italien d’Avi Klemberg et sa musique farcie de clins d’œil assez triviaux (on sait que Strauss n’aimait pas trop les ténors), ou les intrigants Annina/Valzacchi, elle surtout, irrésistible en insinuante Belle de Cadix catapultée dans la Vienne Impériale.
La flopée de petits rôles (notaire, gouvernante, commissaire, acolytes du Baron…) est simplement impeccable.
La complicité et l’intelligence entre l’Orchestre de l’Opéra de Marseille et Philippe Auguin semble s’affirmer de plus en plus. Et ce dès l’ouverture au frémissement réellement réjouissant. La présentation de la rose est comme nimbée d’une féerie de lumière. Partout ailleurs, un élan, une plasticité, une respiration rares. Voilà un Strauss servi au mieux par une équipe jeune et enthousiaste. Un Strauss, qui, une fois encore, increvable, sort victorieux de l’aventure.
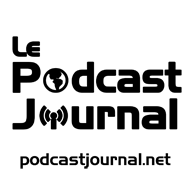









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








