CARTHAGE RENAIT DE SES CENDRES GRACE A L'OPERA DE MARSEILLE
Faut-il ressusciter le marseillais Ernest Reyer dont on vient in loco de fêter le centenaire ?
On pouvait se poser la question à l’issue de la représentation de sa Salammbô, crée à Bruxelles en 1890 et donnée pour la dernière fois sur le ring phocéen voici… soixante huit ans !
Mais, volons à l’essentiel…
Une fois dit que - soyons indulgent - quatre-vingt pour cent de la partition est inchantable (vous comprendrez alors le pourquoi du comment) et que la musique touffue, dense - osant par moments de belles fusées orchestrales originales, de réjouissantes fulgurances proches du meilleur Wagner avec une scène finale au réel pathos – navigue entre méchoui carthaginois rehaussé d’un tantinet d’harissa frelatée et d’orientalisme de pacotille, on réalise la désaffection d’un certain public et le peu d’intérêt de nos artistes actuels pour ce genre d’ouvrage, qu’il faut placer dans la lignée des indigestes Juive, Huguenots et autre Africaine…
En précisant qu’au début du siècle ces œuvres étaient jouées en alternance, on demeure perplexe… Chacun, selon sa sensibilité, trouvera alors midi à sa porte… O tempora ! o mores…
Pour cet opéra hors de prix, qui, si l’on veut respecter la tradition, réclame, excusez du peu, cinq cent costumes, une flopée de choristes, des décors impressionnants pour brosser ces cinq actes retraçant un épisode des Guerres Puniques revue par Flaubert (les projections de maquettes d’époques apportant alors un bain de fraîcheur historique vivifiant), ces coquins de Renée Auphan et Maurice Xiberras ont opté pour… une mise en espace du meilleur effet.
Réglée par Yves Coudray (qui ne méritait pas ces quelques huées d’une clique conservatrice en mal de péplum de sous préfecture) elle donne soudain une dimension insoupçonnée à ce loukoum indigeste. Quelques colonnes, autel, escaliers, des éclairages au scalpel signés par Philippe Grosperrin, suffisent à brosser le cadre du drame.
Si l’on reste en haleine pour suivre les amours contrariées de Matho et de sa belle Salammbô c’est quand même grâce à eux.
A Lawrence Forster également. Amoureux fou éperdu de notre répertoire oublié ou délaissé (on lui doit au disque un Œdipe d’Enesco de référence), buvant de l’œil et de l’oreille fosse et plateau, attentif à tout et à tous (chœurs qui se reçoivent comme des uppercuts en pleine poitrine), il donne des ailes à la phalange marseillaise, fait monter la mayonnaise avec une lecture un rien intellectualisée certes, mais toujours pleine de soudaine poésie, justesse, fidélité à l’esprit de l’œuvre et de son époque.
La distribution réunie pour l’occasion est en majorité française. Et c’est tant mieux.
Consciente de l’enjeu, elle se jette à corps et voix perdus dans le magma du compositeur marseillais et s’en tire avec honneur, éclat et brio.
Avec son physique de star hollywoodienne, belle à damner toutes les légions de Carthage, Rome et leurs objets rapportés, la mezzo américaine Kate Aldrich, sans l’ombre d’une difficulté et dans un français irréprochable, virtuose, irrésistible d’aisance, transcende et porte aux nues un rôle-titre qui donne le tournis.
Gilles Ragon (Matho) dès les premières notes surprend, étonne, éblouit de bout en bout de la soirée. Le meilleur Werther, Hoffmann et Des Grieux de sa génération séduit par l’engagement, la vaillance de ses aigus, montre une classe royale, un mordant et une ampleur sonore rares.
Qui osera lui offrir un grand rôle wagnérien ?
Rien à jeter non plus avec le Grand Prêtre de Sébastien Guèze. Percutant, jeune, frais, solaire, ses longues et difficiles interventions renvoient aux oubliettes les récentes et décevantes pseudos prestations de certains ténors à tout faire des maisons de disques.
Solide comme un roc, Jean-Philippe Lafont ne fait qu’une bouchée d’Hamilcar. Mais le rôle est vraiment bref. Un amusement donc pour le baryton toulousain.
Satisfecit global pour les quatre clefs de fa (Heyboer, Garcin, Martin-Bonnet, Smilek). Parfaits, simplement parfaits. De tels seconds rôles si superbement campés… on en redemande…
On l’aura compris. Une œuvre mineure, défendue avec talent et conviction par une troupe enthousiaste.
Pour finalement, une soirée pas si perdue que cela.
On pouvait se poser la question à l’issue de la représentation de sa Salammbô, crée à Bruxelles en 1890 et donnée pour la dernière fois sur le ring phocéen voici… soixante huit ans !
Mais, volons à l’essentiel…
Une fois dit que - soyons indulgent - quatre-vingt pour cent de la partition est inchantable (vous comprendrez alors le pourquoi du comment) et que la musique touffue, dense - osant par moments de belles fusées orchestrales originales, de réjouissantes fulgurances proches du meilleur Wagner avec une scène finale au réel pathos – navigue entre méchoui carthaginois rehaussé d’un tantinet d’harissa frelatée et d’orientalisme de pacotille, on réalise la désaffection d’un certain public et le peu d’intérêt de nos artistes actuels pour ce genre d’ouvrage, qu’il faut placer dans la lignée des indigestes Juive, Huguenots et autre Africaine…
En précisant qu’au début du siècle ces œuvres étaient jouées en alternance, on demeure perplexe… Chacun, selon sa sensibilité, trouvera alors midi à sa porte… O tempora ! o mores…
Pour cet opéra hors de prix, qui, si l’on veut respecter la tradition, réclame, excusez du peu, cinq cent costumes, une flopée de choristes, des décors impressionnants pour brosser ces cinq actes retraçant un épisode des Guerres Puniques revue par Flaubert (les projections de maquettes d’époques apportant alors un bain de fraîcheur historique vivifiant), ces coquins de Renée Auphan et Maurice Xiberras ont opté pour… une mise en espace du meilleur effet.
Réglée par Yves Coudray (qui ne méritait pas ces quelques huées d’une clique conservatrice en mal de péplum de sous préfecture) elle donne soudain une dimension insoupçonnée à ce loukoum indigeste. Quelques colonnes, autel, escaliers, des éclairages au scalpel signés par Philippe Grosperrin, suffisent à brosser le cadre du drame.
Si l’on reste en haleine pour suivre les amours contrariées de Matho et de sa belle Salammbô c’est quand même grâce à eux.
A Lawrence Forster également. Amoureux fou éperdu de notre répertoire oublié ou délaissé (on lui doit au disque un Œdipe d’Enesco de référence), buvant de l’œil et de l’oreille fosse et plateau, attentif à tout et à tous (chœurs qui se reçoivent comme des uppercuts en pleine poitrine), il donne des ailes à la phalange marseillaise, fait monter la mayonnaise avec une lecture un rien intellectualisée certes, mais toujours pleine de soudaine poésie, justesse, fidélité à l’esprit de l’œuvre et de son époque.
La distribution réunie pour l’occasion est en majorité française. Et c’est tant mieux.
Consciente de l’enjeu, elle se jette à corps et voix perdus dans le magma du compositeur marseillais et s’en tire avec honneur, éclat et brio.
Avec son physique de star hollywoodienne, belle à damner toutes les légions de Carthage, Rome et leurs objets rapportés, la mezzo américaine Kate Aldrich, sans l’ombre d’une difficulté et dans un français irréprochable, virtuose, irrésistible d’aisance, transcende et porte aux nues un rôle-titre qui donne le tournis.
Gilles Ragon (Matho) dès les premières notes surprend, étonne, éblouit de bout en bout de la soirée. Le meilleur Werther, Hoffmann et Des Grieux de sa génération séduit par l’engagement, la vaillance de ses aigus, montre une classe royale, un mordant et une ampleur sonore rares.
Qui osera lui offrir un grand rôle wagnérien ?
Rien à jeter non plus avec le Grand Prêtre de Sébastien Guèze. Percutant, jeune, frais, solaire, ses longues et difficiles interventions renvoient aux oubliettes les récentes et décevantes pseudos prestations de certains ténors à tout faire des maisons de disques.
Solide comme un roc, Jean-Philippe Lafont ne fait qu’une bouchée d’Hamilcar. Mais le rôle est vraiment bref. Un amusement donc pour le baryton toulousain.
Satisfecit global pour les quatre clefs de fa (Heyboer, Garcin, Martin-Bonnet, Smilek). Parfaits, simplement parfaits. De tels seconds rôles si superbement campés… on en redemande…
On l’aura compris. Une œuvre mineure, défendue avec talent et conviction par une troupe enthousiaste.
Pour finalement, une soirée pas si perdue que cela.

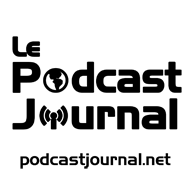









 The 2024 Com.It.Es. Christmas Concert: A Sold-Out Celebration in Monaco
The 2024 Com.It.Es. Christmas Concert: A Sold-Out Celebration in Monaco








