Aîda, Opéra de Chambre ?

Photo DRESSE
Tous les théâtres ne peuvent réussir Aïda. La leçon de goût et de style donnée par l’Opéra de Marseille, pour cette production la plus difficile de Verdi, confirme, s’il le fallait encore, la vitalité de la première scène phocéenne.
Une Aïda intimiste, dans le secret des couloirs pharaoniens, pourquoi pas ?
L’opéra le plus populaire du monde à cause bien sûr de sa marche triomphale et ses trompettes, a tellement excité les montreurs de carton-pâte proposant des visions pseudo-éthiopico-égyptiennes, que l’approche voulue par Charles Roubaud mérite l’attention et surtout le coup d’être tentée.
De simples projections en Trois Dimensions, d’une vérité à la sidérante beauté et à la machinerie bien étudiée, nous plongent au cœur d’une Egypte monumentale, dont on devine que la fraîche pénombre des temples ou alcôves princières rend propice l’angoissante montée du drame.
Voilà donc une Aida intériorisée, restituée à sa dimension humaine, à ses véritables prolongements psychologiques, qui nous permet de retrouver le compositeur que nous connaissons bien, le Verdi des murmures et des déchirures, le Verdi des conflits humains qui caractérisent l’ensemble de son œuvre, celui qui dénonçait déjà l’oppression colonialiste et l’intemporalité du pouvoir ecclésiastique, l’incommunicabilité entre les peuples, et par là même le fanatisme religieux et politique.
Grâce à Charles Roubaud (fort bien secondé comme toujours par les originaux costumes de Katia Duflot et les éclairages pastels de Philippe Grosperrin) l’ouvrage retrouve un tout autre ton et acquiert une dimension nouvelle dans laquelle les sentiments l’emportent sur l’emphase et l’émission sur la déclamation. Ici à Marseille, Aida devient la même histoire d’amour que Luisa Miller ou Traviata…
Dans la fosse, même heureuse surprise ! Un cairote pour diriger Aïda que demander de mieux ? Nader Abassi, avec son drive prodigieux, son génie du mouvement et du son – on avait bien aimé son Ballo la saison passée – nous convie à une véritable fête de la vie théâtrale. De la fosse se dégagent tous les parfums d’une Egypte en cinémascope pour le Verdi le plus rutilant, le plus sensuel, le plus simplement beau entendu sur le Vieux Port depuis longtemps.
Véritable découverte, cerise juteuse et sucrée sur le gâteau d’une soirée bénie des Dieux – fussent-ils maudits par tous ! – l’américaine Adina Aaron est une Aida au chant extatique, d’une rare splendeur, surtout à partir de l’acte du Nil où jamais la souffrance de l’héroïne partagée entre devoir et amour n’a été vécue avec autant de dignité, de noblesse.
Face à elle, peut-être l’Amnéris de ce nouveau siècle.
Prise de rôle réussie pour la grande, la belle, la sympathique, la talentueuse Béatrice Uria-Monzon.
Toutes griffes dehors, volcan en fusion, mais vipère écrasée d’avance, d’une violence presque racinienne – il y a de l’Hermione dans cette fille de Roi ! – exceptionnelle de sentiment et de lyrisme, loin des matrones burinées ou emperlousées de ses plus illustres consoeurs, » BUM » renouvelle un personnage et réussit ce tour de force à faire passer dans la scène du jugement sa propre agonie. Inouï !
Même si les aigus manquaient un rien d’éclat, même si on aurait aimé des couleurs plus variées, Walter Fraccaro a rempli honorablement son contrat en Radamès athlétique… Ne chipotons pas devant la pénurie actuelle de vrais ténors « spinto « …
Renouvelant son exploit orangeois d’il y a deux ans, Ko Seng-Hyoun fut encore une fois un Amonasro de luxe, bondissant, claironnant. Avec des graves profonds et larges comme le Delta du Nil, les deux basses (Wojtek Smilek et Dmitry Ylyanov) achèvent de nous séduire.
Satisfecit global pour les chœurs et les autres protagonistes.
En conclusion, un spectacle où l’intelligence, la réflexion et la recherche intellectuelle ne renient pas une certaine recherche de l’esthétique et de la simple beauté plastique.
Une Aïda intimiste, dans le secret des couloirs pharaoniens, pourquoi pas ?
L’opéra le plus populaire du monde à cause bien sûr de sa marche triomphale et ses trompettes, a tellement excité les montreurs de carton-pâte proposant des visions pseudo-éthiopico-égyptiennes, que l’approche voulue par Charles Roubaud mérite l’attention et surtout le coup d’être tentée.
De simples projections en Trois Dimensions, d’une vérité à la sidérante beauté et à la machinerie bien étudiée, nous plongent au cœur d’une Egypte monumentale, dont on devine que la fraîche pénombre des temples ou alcôves princières rend propice l’angoissante montée du drame.
Voilà donc une Aida intériorisée, restituée à sa dimension humaine, à ses véritables prolongements psychologiques, qui nous permet de retrouver le compositeur que nous connaissons bien, le Verdi des murmures et des déchirures, le Verdi des conflits humains qui caractérisent l’ensemble de son œuvre, celui qui dénonçait déjà l’oppression colonialiste et l’intemporalité du pouvoir ecclésiastique, l’incommunicabilité entre les peuples, et par là même le fanatisme religieux et politique.
Grâce à Charles Roubaud (fort bien secondé comme toujours par les originaux costumes de Katia Duflot et les éclairages pastels de Philippe Grosperrin) l’ouvrage retrouve un tout autre ton et acquiert une dimension nouvelle dans laquelle les sentiments l’emportent sur l’emphase et l’émission sur la déclamation. Ici à Marseille, Aida devient la même histoire d’amour que Luisa Miller ou Traviata…
Dans la fosse, même heureuse surprise ! Un cairote pour diriger Aïda que demander de mieux ? Nader Abassi, avec son drive prodigieux, son génie du mouvement et du son – on avait bien aimé son Ballo la saison passée – nous convie à une véritable fête de la vie théâtrale. De la fosse se dégagent tous les parfums d’une Egypte en cinémascope pour le Verdi le plus rutilant, le plus sensuel, le plus simplement beau entendu sur le Vieux Port depuis longtemps.
Véritable découverte, cerise juteuse et sucrée sur le gâteau d’une soirée bénie des Dieux – fussent-ils maudits par tous ! – l’américaine Adina Aaron est une Aida au chant extatique, d’une rare splendeur, surtout à partir de l’acte du Nil où jamais la souffrance de l’héroïne partagée entre devoir et amour n’a été vécue avec autant de dignité, de noblesse.
Face à elle, peut-être l’Amnéris de ce nouveau siècle.
Prise de rôle réussie pour la grande, la belle, la sympathique, la talentueuse Béatrice Uria-Monzon.
Toutes griffes dehors, volcan en fusion, mais vipère écrasée d’avance, d’une violence presque racinienne – il y a de l’Hermione dans cette fille de Roi ! – exceptionnelle de sentiment et de lyrisme, loin des matrones burinées ou emperlousées de ses plus illustres consoeurs, » BUM » renouvelle un personnage et réussit ce tour de force à faire passer dans la scène du jugement sa propre agonie. Inouï !
Même si les aigus manquaient un rien d’éclat, même si on aurait aimé des couleurs plus variées, Walter Fraccaro a rempli honorablement son contrat en Radamès athlétique… Ne chipotons pas devant la pénurie actuelle de vrais ténors « spinto « …
Renouvelant son exploit orangeois d’il y a deux ans, Ko Seng-Hyoun fut encore une fois un Amonasro de luxe, bondissant, claironnant. Avec des graves profonds et larges comme le Delta du Nil, les deux basses (Wojtek Smilek et Dmitry Ylyanov) achèvent de nous séduire.
Satisfecit global pour les chœurs et les autres protagonistes.
En conclusion, un spectacle où l’intelligence, la réflexion et la recherche intellectuelle ne renient pas une certaine recherche de l’esthétique et de la simple beauté plastique.
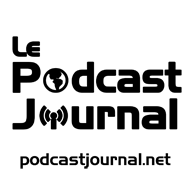









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








