A la découverte d'un interlude inconnu

Importée du Festival Puccini à Torre del Lago (où elle a fait paraît-il grande impression cet été) la production signée par l’ancien directeur de l’Opéra de Nice a ouvert en demi teinte la saison lyrique.
Rarement à l’affiche en France le chef d’œuvre atypique du jeune Puccini - et son premier vrai triomphe - avait donc de quoi soulever la curiosité et l’intérêt.
Autant le dire de suite, on sort du spectacle un tantinet déçu.
Sur le vaste ring italien, Paul-Emile Fourny avait su certainement trouver un réel pouvoir évocateur au drame de l’abbé Prévost, mais, délocalisées sur la scène niçoise, les amours malheureuses de Manon Lescaut et de son Chevalier Des Grieux peinent à prendre leur envol.
Dans un décor imposant et unique signé Poppi Ranchetti (les ruines d’une église désaffectée !?) que l’on imaginerait plus pour le Trovatore de Verdi ou La Favorite de Donizetti, on ne partage que rarement durant quatre actes les affres et tourments du couple le plus célèbre de la littérature française.
Quelques fumigènes pour créer l’ambiance au III, des scènes de foules vues et revues, des poncifs, des clichés, des poses d’un autre âge, ne peuvent racheter deux ou trois bonnes idées - comme ces courtisans/pantins luxueusement habillés par Giovanna Fiorentini ou ce petit pas de deux de bon aloi - hélas vite brisées par l’étroitesse du plateau, voire une économie ou pénurie de moyens évidente.
O Rage O désespoir, le très attendu car grandiose et dramatique tableau du Port du Havre ne pouvait que tomber naturellement… à l’eau…
Si l’on s’attache un peu à l’ouvrage c’est grâce à Puccini et à lui seul. Car même en fermant les yeux il fallait une bonne dose de courage et une foi de pèlerin pour partager les malheurs de ces deux tourtereaux (inventant au passage en plein XVIIIe l’amour libre), leurs ardeurs amoureuses relevant ici d’un film de série B.
Droit sur ses ergots, le ténor chinois Warren Mok, sincère et passionné dans son jeu n’aura séduit que les amateurs de chant en force, aux aigus généreux, un rien braillards.
Ses airs passant dans l’indifférence générale, pas toujours dans la portée, parfois en décalage avec le chef, l’artiste s’arrange avec une intelligence diabolique d’une partition pour lequel il n’est vocalement pas fait, inventant par moments un sympathique sprechgesang puccinien du plus drôle effet. Une prise de rôle entre gris clair et gris foncé… Dès lors il lui sera beaucoup pardonné…
Le vétéran Luigi Roni, emperruqué et poudré comme pas deux, au métier assuré, d’une voix usée jusqu’à la trame aux restes glorieux, racle par moments les fonds de tiroir mais donne une épaisseur que l’on ne connaissait pas au ridicule et malfaisant barbon Géronte, alors que la star locale Jean-Luc Ballestra campe un Lescaut bien peu vil et insidieux (en vrai salopard c’est lui qui vend sa sœur !) plutôt jeune chien fou bondissant, mordant, aux péchés vocaux vite oubliés.
Avec des chœurs bien en place, la demi douzaine de seconds rôles va du simplement correct à l’insignifiant.
Dans le rôle titre, la milanaise Amarilli Nizza se révèle tout simplement époustouflante. Brûlant littéralement les planches, articulée, dramatique et sincère, la soprano, en grande actrice aussi, traduit souverainement la fraîcheur, le brillant, le déchirement du personnage et soutient formidablement un récit par ailleurs superbement conduit. Son engagement vocal va droit au cœur. La douce, l’effacée, l’oie blanche de l’acte un, l’arrogante, l’éternellement fugace du second vous rive sur place. La conclusion, terrible et sauvage, sans échappatoire vous investit lentement, inexorablement.
Plaisir enfin de découvrir in loco Alberto Veronesi. Paroles et musique en tête, le Directeur artistique et musical du Festival Puccini casse réellement la baraque, nous permet de retrouver avec un bonheur non dissimulé la nature viscérale et instinctive du mélodrame, ces finesses orchestrales alliées à la vigueur dramatique.
Aucune emphase dans le fameux Intermezzo du III enfin dénué de toute redondance mais du nerf, une unité de ton et de son rare. La prodigieuse partition pouvait dès lors donner de nombreux frissons aux amateurs du genre.
Surprise du Chef : l’addiction (découverte pour certains dont nous sommes) au deuxième acte d’un curieux interlude symphonique aux cordes voluptueuses et soyeuses, dont on aimerait bien connaître l’origine…
La soirée n’était donc pas si perdue que cela.
Rarement à l’affiche en France le chef d’œuvre atypique du jeune Puccini - et son premier vrai triomphe - avait donc de quoi soulever la curiosité et l’intérêt.
Autant le dire de suite, on sort du spectacle un tantinet déçu.
Sur le vaste ring italien, Paul-Emile Fourny avait su certainement trouver un réel pouvoir évocateur au drame de l’abbé Prévost, mais, délocalisées sur la scène niçoise, les amours malheureuses de Manon Lescaut et de son Chevalier Des Grieux peinent à prendre leur envol.
Dans un décor imposant et unique signé Poppi Ranchetti (les ruines d’une église désaffectée !?) que l’on imaginerait plus pour le Trovatore de Verdi ou La Favorite de Donizetti, on ne partage que rarement durant quatre actes les affres et tourments du couple le plus célèbre de la littérature française.
Quelques fumigènes pour créer l’ambiance au III, des scènes de foules vues et revues, des poncifs, des clichés, des poses d’un autre âge, ne peuvent racheter deux ou trois bonnes idées - comme ces courtisans/pantins luxueusement habillés par Giovanna Fiorentini ou ce petit pas de deux de bon aloi - hélas vite brisées par l’étroitesse du plateau, voire une économie ou pénurie de moyens évidente.
O Rage O désespoir, le très attendu car grandiose et dramatique tableau du Port du Havre ne pouvait que tomber naturellement… à l’eau…
Si l’on s’attache un peu à l’ouvrage c’est grâce à Puccini et à lui seul. Car même en fermant les yeux il fallait une bonne dose de courage et une foi de pèlerin pour partager les malheurs de ces deux tourtereaux (inventant au passage en plein XVIIIe l’amour libre), leurs ardeurs amoureuses relevant ici d’un film de série B.
Droit sur ses ergots, le ténor chinois Warren Mok, sincère et passionné dans son jeu n’aura séduit que les amateurs de chant en force, aux aigus généreux, un rien braillards.
Ses airs passant dans l’indifférence générale, pas toujours dans la portée, parfois en décalage avec le chef, l’artiste s’arrange avec une intelligence diabolique d’une partition pour lequel il n’est vocalement pas fait, inventant par moments un sympathique sprechgesang puccinien du plus drôle effet. Une prise de rôle entre gris clair et gris foncé… Dès lors il lui sera beaucoup pardonné…
Le vétéran Luigi Roni, emperruqué et poudré comme pas deux, au métier assuré, d’une voix usée jusqu’à la trame aux restes glorieux, racle par moments les fonds de tiroir mais donne une épaisseur que l’on ne connaissait pas au ridicule et malfaisant barbon Géronte, alors que la star locale Jean-Luc Ballestra campe un Lescaut bien peu vil et insidieux (en vrai salopard c’est lui qui vend sa sœur !) plutôt jeune chien fou bondissant, mordant, aux péchés vocaux vite oubliés.
Avec des chœurs bien en place, la demi douzaine de seconds rôles va du simplement correct à l’insignifiant.
Dans le rôle titre, la milanaise Amarilli Nizza se révèle tout simplement époustouflante. Brûlant littéralement les planches, articulée, dramatique et sincère, la soprano, en grande actrice aussi, traduit souverainement la fraîcheur, le brillant, le déchirement du personnage et soutient formidablement un récit par ailleurs superbement conduit. Son engagement vocal va droit au cœur. La douce, l’effacée, l’oie blanche de l’acte un, l’arrogante, l’éternellement fugace du second vous rive sur place. La conclusion, terrible et sauvage, sans échappatoire vous investit lentement, inexorablement.
Plaisir enfin de découvrir in loco Alberto Veronesi. Paroles et musique en tête, le Directeur artistique et musical du Festival Puccini casse réellement la baraque, nous permet de retrouver avec un bonheur non dissimulé la nature viscérale et instinctive du mélodrame, ces finesses orchestrales alliées à la vigueur dramatique.
Aucune emphase dans le fameux Intermezzo du III enfin dénué de toute redondance mais du nerf, une unité de ton et de son rare. La prodigieuse partition pouvait dès lors donner de nombreux frissons aux amateurs du genre.
Surprise du Chef : l’addiction (découverte pour certains dont nous sommes) au deuxième acte d’un curieux interlude symphonique aux cordes voluptueuses et soyeuses, dont on aimerait bien connaître l’origine…
La soirée n’était donc pas si perdue que cela.
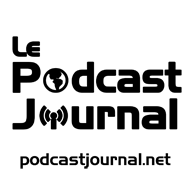









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








