
La manifestation de la folie dans la rue n’est qu’un aspect de l’ampleur de la maladie mentale au Bénin. (Crédits: Polycarpe TOVIHO)
Boire et déboires. Il n’y a pas autre chose à raconter sur la vie de Joseph. Le regard vitreux, tremblotant, l’haleine avinée, cet homme de 34 ans est un accro du sodabi, vin de palme de fabrication locale. Cultivant la terre dans son village à Savi, il est venu à Cotonou, en 2006, pour échapper aux interpellations «agaçantes» de ses proches sur son addiction à l’alcool. Mais rien n’y fit. A Cotonou, la relative ampleur des revenus de son nouveau métier de Zémidjan, conducteur de taxi-moto, lui permet de continuer à lever le verre de trop. Aujourd’hui, il est l’ombre de lui-même, incapable de conduire son taxi-moto, vivant de bricolages, ayant rarement de quoi faire un repas mais toujours fidèle à la fontaine de l’alcool. Joseph n’a aucune force physique ni intérieure pour d’arrêter son ivrognerie, sa déliquescence organique et morale. Il ne sait même pas, comme tant de Béninois, que l’alcoolisme est une maladie mentale. Pourtant, le centre Jacquot de Cotonou qui est l’hôpital psychiatrique de référence du pays a tout un département qui prend en charge les toxicomanes (drogues, alcool, amphétamines).
Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) menée au Bénin en décembre 2009, la consommation de l’alcool prend des proportions alarmantes. Environ, 33% des hommes consomment au moins cinq verres d’alcool par jour et 25,1% des femmes prennent au moins quatre verres par jour, révèle l’étude. «L’alcoolisme a atteint un niveau élevé chez les jeunes», renchérit Dr Mathieu Tognidè, directeur du centre Jacquot. Un centre qui, dans la prise en charge de la toxicomanie, affiche 35% seulement de taux de guérison. «Mais aux Etats-Unis, on est à 45%...», dédramatise Dr Tognidè.
Selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) menée au Bénin en décembre 2009, la consommation de l’alcool prend des proportions alarmantes. Environ, 33% des hommes consomment au moins cinq verres d’alcool par jour et 25,1% des femmes prennent au moins quatre verres par jour, révèle l’étude. «L’alcoolisme a atteint un niveau élevé chez les jeunes», renchérit Dr Mathieu Tognidè, directeur du centre Jacquot. Un centre qui, dans la prise en charge de la toxicomanie, affiche 35% seulement de taux de guérison. «Mais aux Etats-Unis, on est à 45%...», dédramatise Dr Tognidè.
Nombreux sont les jeunes
Les centres ou unités psychiatriques sont généralement occupés par les psychotiques chroniques connus sous le nom de «fous». Dans cet ensemble, les nuances sont nombreuses : ceux qui souffrent de schizophrénie, de psychoses hallucinatoires chroniques et de psychoses maniaco-dépressives… Ensuite, il y a les déprimés. Ce sont les plus nombreux au plan national : l’étude faite récemment à Cotonou sur plus de mille Béninois a révélé un trois-centaine d’individus en proie à la dépression. Les individus souffrant de névroses sont rarement internés ; ils sont souvent traités en ambulatoire, indique le directeur du centre Jacquot.
Dans la pyramide des âges, les jeunes sont les plus nombreux parmi les malades mentaux. La raison est toute simple : «ils sont majoritairement confrontés aux difficultés scolaires, d’apprentissage, au chômage, à la drogue, à l’alcoolisme…», explique Dr Tognidè.
Amélie, aujourd’hui 46 ans, a eu sa première crise alors qu’elle était en classe de Seconde. «Je me souviens dans la période, je n’arrivais pas à dormir la nuit. Ensuite, j’ai commencé par délirer et parfois je suis violente avec mon entourage», raconte-t-elle.
Comme Amélie, Aude Beaudoin, il y a 10 ans, a été confronté à la maladie mentale pendant alors qu’il était au collège. «Après une évaluation en classe, je suis revenu à la maison et c’est là que j’ai commencé par dire des choses qui ne tenaient pas la route. Mes parents ont estimé que je m'étais surmenée lors des révisions de mes cours et qu’il fallait me reposer un peu. Mais chaque jour, le mal empirait davantage, je ne faisais que délirer. Je n’arrivais plus à dormir. J’étais irritable. Mes yeux étaient constamment rouges, très rouges», se souvient Aude Beaudoin qui, abandonnée de ses parents, a été récupérée et soignée par le centre de traitement des malades mentaux d’Avrankou : «aujourd’hui, je suis guérie et je consacre ma vie au centre en aidant les autres malades à guérir…Je ne veux plus retourner dans ma famille parce que je me sens mieux ici».
On ne connaît pas non plus les parents de Aliou, raflé un jour dans les rues de Cotonou par la municipalité et interné au centre Jacquot. Il ne parle pas, ne sourit pas, toujours hagard, profondément introverti, portant seul la croix de sa vie. S’en sortira-t-il ? La réponse du médecin traitant est pleine de doute : «il y a quelque chose d’essentiel dans la guérison de la maladie mentale : il faut qu’elle soit prise en charge très tôt. Si on la laisse se chroniciser, les choses se compliquent…».
Dans la pyramide des âges, les jeunes sont les plus nombreux parmi les malades mentaux. La raison est toute simple : «ils sont majoritairement confrontés aux difficultés scolaires, d’apprentissage, au chômage, à la drogue, à l’alcoolisme…», explique Dr Tognidè.
Amélie, aujourd’hui 46 ans, a eu sa première crise alors qu’elle était en classe de Seconde. «Je me souviens dans la période, je n’arrivais pas à dormir la nuit. Ensuite, j’ai commencé par délirer et parfois je suis violente avec mon entourage», raconte-t-elle.
Comme Amélie, Aude Beaudoin, il y a 10 ans, a été confronté à la maladie mentale pendant alors qu’il était au collège. «Après une évaluation en classe, je suis revenu à la maison et c’est là que j’ai commencé par dire des choses qui ne tenaient pas la route. Mes parents ont estimé que je m'étais surmenée lors des révisions de mes cours et qu’il fallait me reposer un peu. Mais chaque jour, le mal empirait davantage, je ne faisais que délirer. Je n’arrivais plus à dormir. J’étais irritable. Mes yeux étaient constamment rouges, très rouges», se souvient Aude Beaudoin qui, abandonnée de ses parents, a été récupérée et soignée par le centre de traitement des malades mentaux d’Avrankou : «aujourd’hui, je suis guérie et je consacre ma vie au centre en aidant les autres malades à guérir…Je ne veux plus retourner dans ma famille parce que je me sens mieux ici».
On ne connaît pas non plus les parents de Aliou, raflé un jour dans les rues de Cotonou par la municipalité et interné au centre Jacquot. Il ne parle pas, ne sourit pas, toujours hagard, profondément introverti, portant seul la croix de sa vie. S’en sortira-t-il ? La réponse du médecin traitant est pleine de doute : «il y a quelque chose d’essentiel dans la guérison de la maladie mentale : il faut qu’elle soit prise en charge très tôt. Si on la laisse se chroniciser, les choses se compliquent…».
«Je sens la mort»
Germain (26 ans), lui, a sans doute des chances de guérir de ses maux de tête chroniques pour lesquels il a essayé toutes sortes de médicaments. «Le psychiatre trouve que c’est le divorce de mes parents qui est à l’origine de ce mal. Au début, j’étais incrédule même si je reconnais que leur séparation m’avait beaucoup surpris et choqué», explique Germain qui, malgré ses séances dans une unité psychiatrique privée, n’est pas encore totalement sorti de l’ornière. «Mais il y a une nette amélioration. Entre temps, j’ai découvert une église évangélique où je vais régulièrement prier. Cela m’aide beaucoup dans mon processus de guérison», souligne-t-il.
Pierre va dans le même centre que Germain. Pierre n’est pas son vrai nom ; nous le baptisons ainsi parce qu’il a requis l’anonymat total. Ce militaire de l’armée béninoise avait servi comme casque bleu des Nations unies en Côte d’Ivoire en 2004. Pendant son service, il a dit avoir vu «trop d’atrocités». Son unité était chargée d’enterrer les cadavres qui jonchaient les rues ou de relever les charniers. Une opération de nettoyage qui a laissé sur Pierre des traces indélébiles. «J’ai constamment l’impression de puer l’odeur pestilentielle de cadavres. Je sens la mort. Je suis obligé de me laver plusieurs fois par jour. Je crache tout le temps ; je vomis sans raison. Je ne peux plus manger de la viande ni du poisson. Je n’arrive qu’à consommer des crabes…», raconte Pierre qui souffre, selon son médecin, de «névrose post-traumatique». Le médecin lui promet que ça passera mais Pierre se demande sérieusement s’il peut totalement guérir sans quitter l’armée.
Comme on le voit avec Pierre, la maladie mentale fait basculer la vie sans concession. Guéris, améliorés ou condamnés, les malades restent, pour la plupart, profondément marqués à jamais. Amélie qui rêvait d’être enseignante n’a pas pu avoir le BAC. Même si elle a pu se marier, elle est aujourd’hui loin de son ménage et vit l’amélioration de son état de santé avec un goût d’inachevé : «la seule chose qui me manque, ce sont mes deux filles qui sont restées avec leur papa au Gabon. Cela fait six ans que je ne les ai pas vues», confie-t-elle la voix émue. Germain, avec ses migraines irrépressibles, est obligé de renoncer à sa passion des études. Il rêvait d’être inspecteur du trésor ; il est aujourd’hui vendeur de consommables informatiques. Et combien sont-ils encore pétris de talents à faire le pied de grue dans les couloirs de l’hôpital psychiatrique en attendant d’avoir un jour la plénitude de tous leurs moyens ? Même si le centre Jacquot arrive à guérir les trois quarts de ses patients, combien arrivent réellement à renouer avec la vie ?
Pierre va dans le même centre que Germain. Pierre n’est pas son vrai nom ; nous le baptisons ainsi parce qu’il a requis l’anonymat total. Ce militaire de l’armée béninoise avait servi comme casque bleu des Nations unies en Côte d’Ivoire en 2004. Pendant son service, il a dit avoir vu «trop d’atrocités». Son unité était chargée d’enterrer les cadavres qui jonchaient les rues ou de relever les charniers. Une opération de nettoyage qui a laissé sur Pierre des traces indélébiles. «J’ai constamment l’impression de puer l’odeur pestilentielle de cadavres. Je sens la mort. Je suis obligé de me laver plusieurs fois par jour. Je crache tout le temps ; je vomis sans raison. Je ne peux plus manger de la viande ni du poisson. Je n’arrive qu’à consommer des crabes…», raconte Pierre qui souffre, selon son médecin, de «névrose post-traumatique». Le médecin lui promet que ça passera mais Pierre se demande sérieusement s’il peut totalement guérir sans quitter l’armée.
Comme on le voit avec Pierre, la maladie mentale fait basculer la vie sans concession. Guéris, améliorés ou condamnés, les malades restent, pour la plupart, profondément marqués à jamais. Amélie qui rêvait d’être enseignante n’a pas pu avoir le BAC. Même si elle a pu se marier, elle est aujourd’hui loin de son ménage et vit l’amélioration de son état de santé avec un goût d’inachevé : «la seule chose qui me manque, ce sont mes deux filles qui sont restées avec leur papa au Gabon. Cela fait six ans que je ne les ai pas vues», confie-t-elle la voix émue. Germain, avec ses migraines irrépressibles, est obligé de renoncer à sa passion des études. Il rêvait d’être inspecteur du trésor ; il est aujourd’hui vendeur de consommables informatiques. Et combien sont-ils encore pétris de talents à faire le pied de grue dans les couloirs de l’hôpital psychiatrique en attendant d’avoir un jour la plénitude de tous leurs moyens ? Même si le centre Jacquot arrive à guérir les trois quarts de ses patients, combien arrivent réellement à renouer avec la vie ?
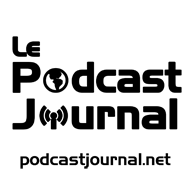









 Les dernières actus du Gabon
Les dernières actus du Gabon








