De l’autre côté de la raison

Dans les familles, les malades mentaux vivent une terrible détention. (Crédits: Polycarpe TOVIHO)
Quel Béninois peut se targuer de n’avoir jamais rencontré un fou ? Ils sont si nombreux dans la rue, si reconnaissables dans leurs haillons et sous leurs traits faméliques, défaits…la plupart du temps condamnés à une errance sans fin. J’en rencontre presque tous les jours ; souvent je détourne mon regard pour avoir la conscience tranquille. Mais toujours, je me dis : ce fou est sans aucun doute le père, la mère, l’enfant, le frère, la sœur ou l’ami de quelqu’un. Pourquoi personne ne vient le soustraire à cette visibilité dérangeante ? Pourquoi l’Etat n’intervient pas ? Pourquoi… ?
Le premier drame de la folie chez nous, c’est l’isolement, ce désamour qui dépouille le fou de tout lien familial et social. Ici, le fou est si seul dans son existence où il est déjà esclave de son corps et de son esprit.
C’est dans ce monde de profonde solitude et de souffrance absolue que j’ai décidé d’entrer pour comprendre pourquoi notre société traite ainsi ses fous.
Sur le perron de cet univers, j’étais hésitant, apeuré, sur le qui-vive à l’idée de faire face à la violence, de confronter ma raison à la déraison, à l’incohérence du discours et des gestes. Dans une société où on raconte tant de choses sur la folie, le risque que mon propre raisonnement finisse par se déliter me pesait, me tourmentait presque. Puis j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai franchi le pas.
Mais contre toute attente, ma première difficulté fut le mur de silence qui entoure le monde psychiatrique. Les familles me ferment la porte au nez. Les malades dont l’état de santé s’est amélioré s’emmurent dans «l’omerta». Par trois fois, des psychiatres ont essayé de me mettre en contact avec certains de ces convalescents pour qu’ils racontent leur histoire. Niet ! Pour la plupart d’entre eux, se confier à un journaliste serait reconnaître leur folie et s’exposer à la méfiance sociale.
Les pouvoirs publics aussi ne parlent pas beaucoup. Pas facile de dégoter un responsable au ministère de la Santé pour expliquer l’incurie de l’Etat dans la promotion de la santé mentale. Tous ceux que j’ai contactés au ministère m’aiguillent vers l’hôpital psychiatrique de référence du pays : Jacquot. Même le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles chargé de faire la promotion de la santé mentale n’a pas trouvé mieux que de m’indiquer le service de psychiatrie du grand centre hospitalier et universitaire de Cotonou. Sachant très bien que ce sont là des hôpitaux, c’est-à-dire des lieux de soins et non des centres de prise de décisions.
Les autorités municipales de Cotonou qui, dans le cadre de l’assainissement de l’espace public, ont l’habitude de faire de brutales rafles dans les rangs des fous n’ont pas grand-chose à dire quand on leur donne la parole : «le fou ne doit pas résider dans la rue. C’est une question de salubrité publique», dit-on ici sèchement. Ce qui choque dans l’attitude de la mairie, c’est de ne pas pouvoir proposer une solution honorable alors même que la loi donne compétence aux communes d’ouvrir des asiles.
En revanche, les seuls à vouloir vraiment parler, ce sont les psychiatres qui n’hésitent pas à accabler l’Etat dans le dénuement de l’hôpital psychiatrique et sonner l’alerte sur le fait que la maladie mentale menace dangereusement le développement national.
Mais les plus volubiles, ce sont les malades en traitement dans les centres de soins visités. J’ai tellement entendu d’eux que j’ai fini par craindre que ça ne tourne plus rond chez moi. Difficile de vaincre les a priori…
Dans les centres de soins, à Cotonou comme à Avrankou, j’ai rencontré des gens vraiment malades souffrant dans leur chair mais encore plus meurtris par l’abandon et le fait d’être la risée… Le silence et l’indifférence de leurs proches les rendent encore plus fous !
Il est vrai, il y a beaucoup de parents qui encadrent bien leurs enfants y compris les adultes. Ce sont notamment des mamans qui sont aux petits soins, renonçant à leur propre vie au risque très souvent d’être, à leur tour, stigmatisées et abandonnées. Elles en parlent avec autant de fatalisme que de morgue.
J’ai rencontré des personnes malades, morbides mais aussi des gens extraordinaires parmi les patients en convalescence et les personnels de santé, ces héros anonymes qui pansent les blessures intérieures et soldent les comptes du divorce social. Je les considère comme les derniers repères d’une société dont on dit pourtant qu’elle est réputée pour sa chaleur, son sens de la famille et de la solidarité.
La loi de l’amour est de rigueur au centre d’Avrankou : la folle farandole de joie dans laquelle vivent quotidiennement patients et soigneurs est indescriptible. Parfois, il m’a paru inévitable de participer aux chants et aux danses au péril des règles du métier : un journaliste qui est acteur du film qu’il raconte, avouons que ce n’est pas pro…
Au début de cette enquête, je voulais savoir pourquoi… J’ai eu ce que je voulais : l’hôpital psychiatrique est malade. Il est malade de ce que l’Etat, désargenté et sans volonté politique, viole allègrement le droit aux soins psychiatriques. Malade ensuite de la société toute entière qui, sous l’aiguillon de ses idées reçues, a perdu le nord des vraies valeurs : en considérant la folie non comme une maladie mais comme le fait de la sorcellerie ou un objet de honte, elle ne contribue pas efficacement à la formulation d’une réponse adaptée à la prise en charge du mal.
En attendant que notre société guérisse de ses préjugés et que l’Etat s’organise et organise ses moyens, les malades peuvent compter sur l’argent des bonnes volontés ainsi que sur leur engagement. L’enjeu, c’est bien de mobiliser des ressources pour augmenter et optimiser l’accès aux soins. C’est surtout de lutter pour que les mentalités changent. La mienne a déjà changé parce que mon regard s’est amélioré. Une seule hantise m’est restée à l’issue de cette investigation : l’ineffable fragilité de l’être humain. Passer de l’autre côté de la raison ne tient qu’à un fil. Quand je pense que tant de gens en sont arrivés «à péter les plombs» sur de simples maux de tête, après l’échec à un examen, avec le départ de l’être aimé, le chômage qui n’en finit pas ou juste par manque d’amour… J’y pense et j’ai peur.
Le premier drame de la folie chez nous, c’est l’isolement, ce désamour qui dépouille le fou de tout lien familial et social. Ici, le fou est si seul dans son existence où il est déjà esclave de son corps et de son esprit.
C’est dans ce monde de profonde solitude et de souffrance absolue que j’ai décidé d’entrer pour comprendre pourquoi notre société traite ainsi ses fous.
Sur le perron de cet univers, j’étais hésitant, apeuré, sur le qui-vive à l’idée de faire face à la violence, de confronter ma raison à la déraison, à l’incohérence du discours et des gestes. Dans une société où on raconte tant de choses sur la folie, le risque que mon propre raisonnement finisse par se déliter me pesait, me tourmentait presque. Puis j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai franchi le pas.
Mais contre toute attente, ma première difficulté fut le mur de silence qui entoure le monde psychiatrique. Les familles me ferment la porte au nez. Les malades dont l’état de santé s’est amélioré s’emmurent dans «l’omerta». Par trois fois, des psychiatres ont essayé de me mettre en contact avec certains de ces convalescents pour qu’ils racontent leur histoire. Niet ! Pour la plupart d’entre eux, se confier à un journaliste serait reconnaître leur folie et s’exposer à la méfiance sociale.
Les pouvoirs publics aussi ne parlent pas beaucoup. Pas facile de dégoter un responsable au ministère de la Santé pour expliquer l’incurie de l’Etat dans la promotion de la santé mentale. Tous ceux que j’ai contactés au ministère m’aiguillent vers l’hôpital psychiatrique de référence du pays : Jacquot. Même le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles chargé de faire la promotion de la santé mentale n’a pas trouvé mieux que de m’indiquer le service de psychiatrie du grand centre hospitalier et universitaire de Cotonou. Sachant très bien que ce sont là des hôpitaux, c’est-à-dire des lieux de soins et non des centres de prise de décisions.
Les autorités municipales de Cotonou qui, dans le cadre de l’assainissement de l’espace public, ont l’habitude de faire de brutales rafles dans les rangs des fous n’ont pas grand-chose à dire quand on leur donne la parole : «le fou ne doit pas résider dans la rue. C’est une question de salubrité publique», dit-on ici sèchement. Ce qui choque dans l’attitude de la mairie, c’est de ne pas pouvoir proposer une solution honorable alors même que la loi donne compétence aux communes d’ouvrir des asiles.
En revanche, les seuls à vouloir vraiment parler, ce sont les psychiatres qui n’hésitent pas à accabler l’Etat dans le dénuement de l’hôpital psychiatrique et sonner l’alerte sur le fait que la maladie mentale menace dangereusement le développement national.
Mais les plus volubiles, ce sont les malades en traitement dans les centres de soins visités. J’ai tellement entendu d’eux que j’ai fini par craindre que ça ne tourne plus rond chez moi. Difficile de vaincre les a priori…
Dans les centres de soins, à Cotonou comme à Avrankou, j’ai rencontré des gens vraiment malades souffrant dans leur chair mais encore plus meurtris par l’abandon et le fait d’être la risée… Le silence et l’indifférence de leurs proches les rendent encore plus fous !
Il est vrai, il y a beaucoup de parents qui encadrent bien leurs enfants y compris les adultes. Ce sont notamment des mamans qui sont aux petits soins, renonçant à leur propre vie au risque très souvent d’être, à leur tour, stigmatisées et abandonnées. Elles en parlent avec autant de fatalisme que de morgue.
J’ai rencontré des personnes malades, morbides mais aussi des gens extraordinaires parmi les patients en convalescence et les personnels de santé, ces héros anonymes qui pansent les blessures intérieures et soldent les comptes du divorce social. Je les considère comme les derniers repères d’une société dont on dit pourtant qu’elle est réputée pour sa chaleur, son sens de la famille et de la solidarité.
La loi de l’amour est de rigueur au centre d’Avrankou : la folle farandole de joie dans laquelle vivent quotidiennement patients et soigneurs est indescriptible. Parfois, il m’a paru inévitable de participer aux chants et aux danses au péril des règles du métier : un journaliste qui est acteur du film qu’il raconte, avouons que ce n’est pas pro…
Au début de cette enquête, je voulais savoir pourquoi… J’ai eu ce que je voulais : l’hôpital psychiatrique est malade. Il est malade de ce que l’Etat, désargenté et sans volonté politique, viole allègrement le droit aux soins psychiatriques. Malade ensuite de la société toute entière qui, sous l’aiguillon de ses idées reçues, a perdu le nord des vraies valeurs : en considérant la folie non comme une maladie mais comme le fait de la sorcellerie ou un objet de honte, elle ne contribue pas efficacement à la formulation d’une réponse adaptée à la prise en charge du mal.
En attendant que notre société guérisse de ses préjugés et que l’Etat s’organise et organise ses moyens, les malades peuvent compter sur l’argent des bonnes volontés ainsi que sur leur engagement. L’enjeu, c’est bien de mobiliser des ressources pour augmenter et optimiser l’accès aux soins. C’est surtout de lutter pour que les mentalités changent. La mienne a déjà changé parce que mon regard s’est amélioré. Une seule hantise m’est restée à l’issue de cette investigation : l’ineffable fragilité de l’être humain. Passer de l’autre côté de la raison ne tient qu’à un fil. Quand je pense que tant de gens en sont arrivés «à péter les plombs» sur de simples maux de tête, après l’échec à un examen, avec le départ de l’être aimé, le chômage qui n’en finit pas ou juste par manque d’amour… J’y pense et j’ai peur.
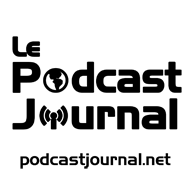









 Les dernières actus du Gabon
Les dernières actus du Gabon








