
Photo © Christian Dresse
Créé en 1846 à la Fenice de Venise, Attila fut très vite ressenti par les italiens comme un opéra patriotique qui résumait "l’agitation et les douleurs qui déchirent notre patrie" et "les aspirations à la liberté nationale" face au "Hun féroce". Y voir bien sûr des expressions d’époque. Cette interprétation trouvait sa justification dans l’ardeur belliqueuse qui traverse toute l’œuvre, dans la fière silhouette d’Odabella, qui, telle Judith, ne s’insinue dans l’intimité du Fléau de Dieu que pour mieux le frapper, venger son père et sa patrie, ainsi que dans les fresques chorales qui décrivent le désarroi d’un peuple soumis à l’envahisseur.
Toutefois, il n’est pas sûr que Verdi ait été sensible à ce seul aspect et qu’il ne se soit pris de sympathie pour ce tyran qui ne manque ni d’ampleur, ni de panache, ni de générosité, mais se heurte, dans sa démesure, à l’ordre de Dieu.
Le plus beau moment de l’œuvre reste bien sûr cette scène où un mauvais rêve instruit Attila des limites que Dieu pose à son pouvoir avant de revivre ce rêve en rencontrant le Pape Léon qui lui barre la route de Rome et devant lequel il plie.
On le voit. La vérité historique est ailleurs. Mais si Attila n’est pas un "grand chef d’œuvre" comparable au Verdi de la maturité, ces moments superbes en font un opéra vivant et très intéressant devant cependant compter avec les maladresses du livret. Le héros en deviendrait presque sympathique, odieuse son exécution sommaire.
Notre compositeur préféré (avec tant d’autres) ne recherchait-il pas plus l’effet poignant que la nuance, la pulsion et le dynamisme que le trait charmant avec des images sonores percutantes et des situations exceptionnelles ? Qu’il nous soit permis de poser la question… D’autant que le "rythme héroïque" (versification italienne en sept pieds avec accentuation de la syllabe antépénultième) est ici utilisé au maximum. Écrit un casque sur la tête, Attila, serait-il enfin le chef-d’œuvre du paradoxe ?
Dans le rôle titre Askar Abdrazakov emporte tout sur son passage. On ne sait qu’admirer le plus : sa conviction, la beauté intrinsèque d’une voix à la confondante facilité, au point que l’on croirait le rôle spécialement pour lui. Tout aussi fascinant, l’Ezio de Vittore Vitelli, chevaleresque à souhait, dont le timbre, rappelle irrésistiblement celui du jeune Massard, avec cette pointe irréfutable de ténor sous-jacent.
Pour sa cinquième saison à l’Opéra de Marseille, Giuseppe Gipalli, simplement parfait, a mis le public dans sa poche en deux airs. Du sérieux et du solide également chez les comprimari (Martin-Bonnet-Comparetti).
Reste le cas de Sylvie Valayre. Un physique hollywoodien, un port altier, une conviction de tous les instants… Hélas, la Diva française négocie d’une voix ingrate, inégale, sans couleur, les trois tessitures du rôle meurtrier, mal fagoté, écrit à la va comme je te pousse, d’Odabella…
En ce dimanche pascal, du si bémol grave au contre ut, une prestation aussi agréable qu’une crucifixion au Golgotha… Méritait-elle pour autant les huées du public au rideau final ? Certainement pas…
Giuliano Carella a piloté fosse et plateau avec sensibilité et flamme. Sa direction fine et généreuse pour cette partition de la nuit et de la mort était un des atouts de cette matinée. En prime, la superbe participation des chœurs, dont les interventions se reçoivent comme des uppercuts en pleine poitrine.
Avec une économie de biens qui pour une fois ne nuit pas, Yves Coudray a signé une saisissante mise en espace qui rappelle irrésistiblement le style des années Vilar du glorieux T.N.P. Quelques accessoires, une gestuelle étudiée, la magie des lumières crépusculairement sanguinolentes de Philippe Grosperrin nous changeaient agréablement des reconstitutions pseudo-historiques où même les plus grands se sont luxueusement plantés. Pour au final un résultat franchement efficace, et diaboliquement intelligent.
Toutefois, il n’est pas sûr que Verdi ait été sensible à ce seul aspect et qu’il ne se soit pris de sympathie pour ce tyran qui ne manque ni d’ampleur, ni de panache, ni de générosité, mais se heurte, dans sa démesure, à l’ordre de Dieu.
Le plus beau moment de l’œuvre reste bien sûr cette scène où un mauvais rêve instruit Attila des limites que Dieu pose à son pouvoir avant de revivre ce rêve en rencontrant le Pape Léon qui lui barre la route de Rome et devant lequel il plie.
On le voit. La vérité historique est ailleurs. Mais si Attila n’est pas un "grand chef d’œuvre" comparable au Verdi de la maturité, ces moments superbes en font un opéra vivant et très intéressant devant cependant compter avec les maladresses du livret. Le héros en deviendrait presque sympathique, odieuse son exécution sommaire.
Notre compositeur préféré (avec tant d’autres) ne recherchait-il pas plus l’effet poignant que la nuance, la pulsion et le dynamisme que le trait charmant avec des images sonores percutantes et des situations exceptionnelles ? Qu’il nous soit permis de poser la question… D’autant que le "rythme héroïque" (versification italienne en sept pieds avec accentuation de la syllabe antépénultième) est ici utilisé au maximum. Écrit un casque sur la tête, Attila, serait-il enfin le chef-d’œuvre du paradoxe ?
Dans le rôle titre Askar Abdrazakov emporte tout sur son passage. On ne sait qu’admirer le plus : sa conviction, la beauté intrinsèque d’une voix à la confondante facilité, au point que l’on croirait le rôle spécialement pour lui. Tout aussi fascinant, l’Ezio de Vittore Vitelli, chevaleresque à souhait, dont le timbre, rappelle irrésistiblement celui du jeune Massard, avec cette pointe irréfutable de ténor sous-jacent.
Pour sa cinquième saison à l’Opéra de Marseille, Giuseppe Gipalli, simplement parfait, a mis le public dans sa poche en deux airs. Du sérieux et du solide également chez les comprimari (Martin-Bonnet-Comparetti).
Reste le cas de Sylvie Valayre. Un physique hollywoodien, un port altier, une conviction de tous les instants… Hélas, la Diva française négocie d’une voix ingrate, inégale, sans couleur, les trois tessitures du rôle meurtrier, mal fagoté, écrit à la va comme je te pousse, d’Odabella…
En ce dimanche pascal, du si bémol grave au contre ut, une prestation aussi agréable qu’une crucifixion au Golgotha… Méritait-elle pour autant les huées du public au rideau final ? Certainement pas…
Giuliano Carella a piloté fosse et plateau avec sensibilité et flamme. Sa direction fine et généreuse pour cette partition de la nuit et de la mort était un des atouts de cette matinée. En prime, la superbe participation des chœurs, dont les interventions se reçoivent comme des uppercuts en pleine poitrine.
Avec une économie de biens qui pour une fois ne nuit pas, Yves Coudray a signé une saisissante mise en espace qui rappelle irrésistiblement le style des années Vilar du glorieux T.N.P. Quelques accessoires, une gestuelle étudiée, la magie des lumières crépusculairement sanguinolentes de Philippe Grosperrin nous changeaient agréablement des reconstitutions pseudo-historiques où même les plus grands se sont luxueusement plantés. Pour au final un résultat franchement efficace, et diaboliquement intelligent.
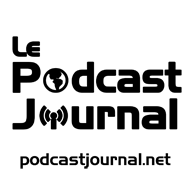









 Les dernières actus du Danemark
Les dernières actus du Danemark








